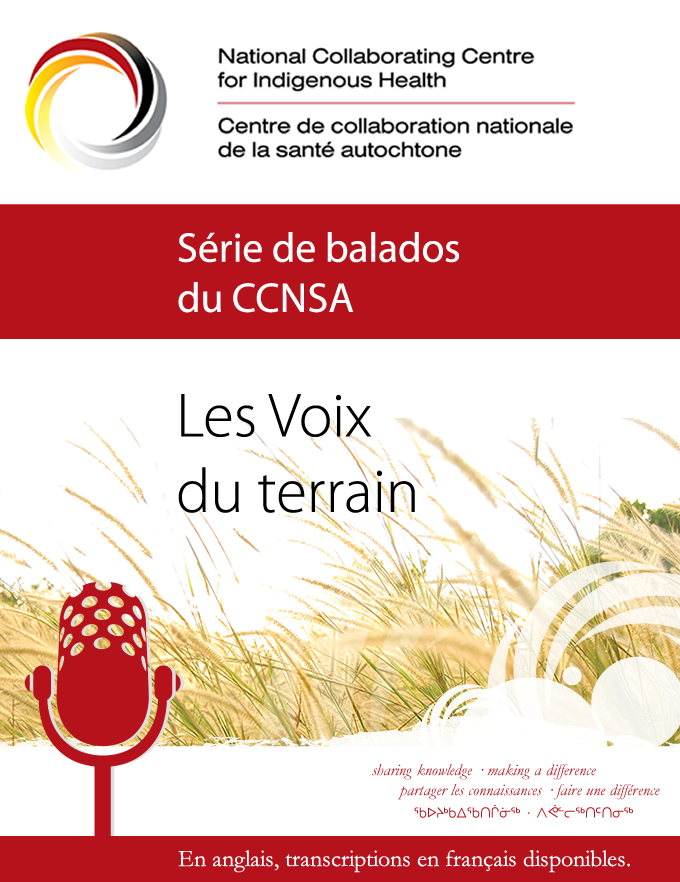 Série de balados Les Voix du terrain
Série de balados Les Voix du terrain
Les Voix du terrain
Bienvenue aux Voix du terrain, une série de balados produite par le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone (CCNSA). Le CCNSA met l’accent sur la recherche innovante et les initiatives communautaires visant à promouvoir la santé et le bien-être des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada.
Épisode 37 – Savoirs autochtones et science pandémique : conversation avec Nicole Redvers
Description
Dans l’épisode d’aujourd’hui, notre animatrice X’staam Hana’ax (Nicole Halbauer) parle avec Nicole Redvers, Ph. D., membre de la Première Nation Denı́nu Kų́ę́ et professeure agrégée à l’Université Western. Madame Redvers oppose la science occidentale à la science autochtone, expose en détail les visions du monde qui les renforcent et les façonnent, et évalue leur capacité à atténuer des problèmes complexes de santé planétaire comme les pandémies.
Selon madame Redvers, une approche autochtone des pandémies comprendrait la reconnaissance et une meilleure compréhension de l’interdépendance existante entre les humains, les animaux et l’environnement, ce qui mènerait à des mesures préventives comme la lutte contre la déforestation et la perte de biodiversité. Elle recommande, en outre, de consulter les peuples et les communautés autochtones dans des domaines comme l’éducation, la politique internationale, la défense de l’environnement et l’intendance des terres.
Pour terminer, madame Redvers relate son cheminement depuis une petite communauté autochtone des Territoires du Nord-Ouest jusqu’à devenir une érudite reconnue partout dans le monde, après avoir réalisé très tôt l’importance de faire des études dans des établissements d’enseignement et des systèmes de connaissances occidentaux, et de les connaître, afin de les changer pour mieux en « tirer parti pour faire le bien ».
Écouter sur SoundCloud (en anglais)
Lire ci-dessous la transcription en français du balado ou la télécharger ici (PDF)
Lire ou télécharger une liste de liens liés (PDF)
Biographies

Nicole Redvers, Ph. D., D. N., M. Sc. (santé publique), est membre de la Première Nation Denı́nu Kų́ę́ (Territoires du Nord-Ouest, Canada) et professeure agrégée, chaire de recherche à l’Université Western et directrice de la santé planétaire autochtone à la faculté de médecine et de dentisterie Schulich de l’Université Western. Elle est actuellement vice-présidente à la recherche de l’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC). Madame Redvers Redvers a déjà occupé des postes précédents à la fois au département de médecine familiale et communautaire et au département de santé autochtone de l’Université du Dakota du Nord, où elle a contribué à la création du premier programme de doctorat en santé autochtone en Amérique du Nord. Elle a été activement impliquée aux niveaux régional, national et international dans la promotion de l’inclusion des perspectives autochtones dans la recherche et la pratique en santé humaine et planétaire.
Madame Redvers siège au sein du Cercle de leadership autochtone en recherche du Comité de coordination de la recherche au Canada (CCRC) et est commissaire de la Commission sur la santé de l’Arctique du Lancet, ainsi que de la Commission du Lancet sur la prévention des débordements viraux. Elle siège également au Comité de pilotage de l’Alliance pour la santé planétaire (PHA) basée à l’Université Johns Hopkins, est membre consultative du Groupe consultatif technique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l’intégration de l’éthique dans la santé et les changements climatiques. Son travail universitaire comprend une foule de projets d’études tentant de combler le fossé existant entre les façons de savoir autochtones et occidentales en ce qui concerne la santé individuelle, communautaire et planétaire.
Madame Redvers est l’autrice du livre de poche d’intérêt général intitulé : « The Science of the Sacred: Bridging Global Indigenous Medicine Systems and Modern Scientific Principles » (La science du sacré : faire le pont entre les systèmes médicaux autochtones mondiaux et les principes scientifiques modernes).

X’staam Hana’ax (Nicole Halbauer) est membre de la communauté Ts’msyen, de Kitsumkalum. Nicole appartient au (clan) Ganhada p’teex de la (Maison) Waap de K’oom. Son travail de défense des droits des résidents du nord de la Colombie-Britannique s’étend sur plus d’une décennie. Elle a œuvré sans relâche pour mettre en place une gouvernance décolonisée au sein des organismes communautaires.
Au-delà de ses rôles professionnels, Nicole est profondément dévouée à sa famille. Son mari et elle ont élevé six enfants, en plus de quelques nièces et neveux, et ont aussi le bonheur d’avoir deux petits-enfants fantastiques, qui occupent tous une place spéciale dans son cœur. Les expériences personnelles de Nicole ont eu une influence marquée sur ses actions communautaires.
Transcription
Nicole Halbauer : [Langue autochtone utilisée]. Bienvenue aux Voix du terrain, une série de balados produite par le Centre de la collaboration nationale de la santé autochtone (CCNSA). Le CCNSA met l’accent sur la recherche innovante et les initiatives communautaires visant à promouvoir la santé et le bien-être des peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada.
– Musique –
Nicole Halbauer : [langue Autochtone utilisée]. Bonjour. Mon nom [langue Autochtone utilisée] est X’staam Hana’ax, et mon nom anglicisé est Nicole Halbauer. J’appartiens au Kitsumkalum Raven Clan et à la Nation Ts’msyen de la House of K’oom établie dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique.
Je suis très heureuse de vous annoncer que je serai l’animatrice du balado d’aujourd’hui, dans lequel nous avons l’immense plaisir de parler avec Nicole Redvers à propos du savoir autochtone et de la science pandémique.
Quel honneur de vous accueillir, madame Redvers! Permettez-moi de vous inviter à vous présenter à notre auditoire.
Nicole Redvers : Mussi Cho, merci. Je suis ravie d’être ici. La journée est plutôt pluvieuse là où je me trouve, mais c’est un moment idéal pour avoir une conversation devant une tasse de thé.
[Langue Autochtone utilisée]. Je m’appelle Nicole Redvers. Mon nom traditionnel est [langue Autochtone utilisée] et je suis membre de la Première Nation Denı́nu Kų́ę́ établie en haut du territoire du Traité no 8, aussi appelé Denendeh, ou Terre du peuple, que l’on nomme aujourd’hui les Territoires du Nord-Ouest. C’est là où je suis née et où j’ai grandi au sein de ma communauté natale, mais aussi à Denı́nu Kų́ę́ ou Fort Resolution, comme il est mentionné… j’ai eu le privilège de me trouver sur les terres de la Kátł'odeeche First Nation et de la Première Nation de West Point pendant la majeure partie de mes années scolaires, dans les environs de la région de la rivière Hay sur la pointe sud de Tu Nedhé, ou du Grand lac des Esclaves.
À l’heure actuelle, je vous parle depuis le berceau traditionnel des peuples Anishinaabe, Haudenosaunee, Wahnapitae, Potawatomi du sud-ouest de l’Ontario, où est située la faculté de médecine et de dentisterie Schulich de l’Université Western. Et [je] me réjouis vraiment de voir les feuilles pousser, le gazon vert et les oiseaux gazouiller, de même que l’oie qui s’agite autour de ses rejetons qui ont un peu grandi. C’est réellement une belle période de l’année.
Nicole Halbauer : En effet. Je suis au domicile de ma fille, en ce moment, et ses lilas doivent avoir dans les 50 ans. Le parfum qui flotte dans l’air du jardin et dans la maison est enivrant. Les lilas! Ils imprègnent un air de printemps à tout.
Madame Redvers, nous nous sommes rencontrées pour la première fois dans un autre webinaire, et notre conversation à propos de la science pandémique et du savoir autochtone m’a tellement intriguée que je n’avais qu’une idée en tête : en parler encore plus avec vous. Alors, quel sens prend pour vous la science autochtone selon votre expérience et dans le travail que vous faites (votre point d’observation particulier)?
Nicole Redvers : Bonne question. Selon moi, et pour toutes les communautés, nous avons souvent des interprétations différentes parce qu’il est évident que la terminologie de la science en soi n’appartient pas vraiment au vocabulaire de notre communauté. Je serais curieuse de savoir de quelle manière les communautés arriveraient à symboliser ce concept dans leurs langues traditionnelles, en règle générale. Mais dans le monde actuel, dans l’optique de la transmission du savoir, notre interprétation de ce que serait une science très rigoureuse et pérenne dans nos communautés selon une perspective euro-occidentale se rapproche de leur vision de la science, d’une certaine manière. Il y a quelques années, peut-être 3 ou 4 ans, nous avons formé un groupe d’étudiants autochtones composé de Détenteurs du savoir, d’Aînés et de défenseurs de la terre. Nous essayions de déterminer ensemble, à l’aide d’un processus consensuel de toutes ces régions du monde, quels étaient les principaux déterminants de la santé planétaire. Autrement dit, il s’agissait d’indiquer les éléments qui favorisent la bonne santé de la planète et les facteurs qui doivent être en place pour que la planète se porte bien.
Et une partie de cette conversation tournait autour des obstacles du paradigme scientifique moderne qui est actuellement un déterminant de la santé planétaire ou un facteur capable d’influer sur elle, et pas nécessairement dans le bon sens. Parce que le groupe considérait qu’il s’agissait d’une science occidentale ayant toujours constitué ce paradigme, qui avait recours à une méthode scientifique précise, qui avait servi à élaborer des théories ou à créer des hypothèses, à trouver des variables et des mesures, et à décrire des relations, ce genre de choses, et qui s’exprime habituellement à l’aide de termes mathématiques, économiques ou parfois même politiques.
Le paradigme de la science occidentale s’est toutefois révélé très limité dans sa capacité à expliquer des relations complexes, surtout celles qui s’échelonnent dans le temps ou sur de longues périodes, et peuvent vraiment être très linéaires. Elle peut s’avérer compartimentée ou réductionniste et très mécaniste, mécanique dans ses opérations. Et dans l’ensemble, en se rendant réellement compte du fait que l’intérêt primordial de la science occidentale a souvent consisté à faire des déductions ou des réflexions sur des phénomènes pour comprendre le monde, mais d’une manière implicite sous-jacente et parfois explicite en tentant d’influer sur le contrôle ou voire peut-être de modifier le phénomène environnemental au profit de l’être humain et pour lui seul, même si ce n’est pas vraiment explicite. Souvent, le genre de questions de recherche qui sont posées et le genre d’études qui sont créées, le sont souvent au profit des êtres humains.
Alors, si nous réfléchissons du point de vue d’une science autochtone et en fait, le sens que je donne à tout cela, c’est plus une approche orientée vers les systèmes, fondée sur l’écologie, le réseautage ou une démarche communautaire qui correspond réellement plus à la compréhension de la complexité. Le groupe, en tant que définition, a défini ou décrit la science autochtone comme étant très contextuelle, holistique, symbolique, non linéaire, relationnelle, non limitée dans le temps, et se sert véritablement de l’observation collective des peuples autochtones pour expliquer des phénomènes naturels par l’entremise de récits réels, mais aussi métaphoriques. Les récits métaphoriques ne dévalorisent pas le processus; il s’agit simplement de notre manière d’expliquer les choses, les connexions dans le monde.
Je dis souvent, dans de nombreux cercles, qu’il nous est impossible de résoudre des problèmes complexes depuis la vision du monde qui les a d’abord créés, puisqu’elle perpétue la déconnexion entre nous en tant que parents et la planète. Cela serait en quelque sorte le point culminant de la plateforme de différence entre la science occidentale et la science autochtone.
Nicole Halbauer :C’est incroyable. Selon mon expérience, il existe de nombreux exemples qui indiquent que si nous avions fait place à la nuance et compris les nuances de la situation, qu’il s’agisse de gouvernance ou de changement systémique, si nous avions fait marche arrière pour avoir la certitude que nous étions vraiment ancrés dans notre lien avec les autres, avec l’environnement dans lequel nous travaillons, nous aurions obtenu de meilleurs résultats. Je sens que cette plénitude dont vous parlez à propos de la science autochtone nous amène vraiment à prendre du recul pour nous assurer de travailler ensemble en tant que groupe, au lieu de renforcer une hiérarchie qui finit par tous nous nuire et nuire à la planète. Notre évolution ne consiste pas à changer, mais à revenir en arrière pour intégrer la santé et le bien-être, au lieu de se cantonner dans des paradigmes individualistes visant ce qui nous convient le mieux en tant que personne; il faudrait plutôt chercher des moyens d’améliorer l’ensemble pour le bien de tous. Et c’est en cela que c’est fantastique, à mon avis.
Dans notre autre webinaire, nous avons parlé de la science pandémique, une chose à laquelle je n’avais vraiment pas réfléchi auparavant. Lorsqu’il est question de science pandémique, à quoi faisons-nous référence? En quoi consiste la science pandémique? Quelles sont ses répercussions sur nous? Ce genre de questions. Que devons-nous savoir à propos de la science pandémique?
Nicole Redvers : Oui, eh bien, cette conversation tombe vraiment à point nommé, puisque l’Assemblée mondiale de la Santé est en cours en ce moment dans le monde, et hier, un Accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies a été conclu. Il s’agit d’un accord entre les nations membres de l’Assemblée mondiale de la Santé de partout dans le monde qui conviennent de certains principes de prévention et de riposte face aux pandémies. Bien entendu, les pandémies sont des événements à grande échelle qui découlent souvent d’une contagion virale, qui circule le plus souvent d’animaux aux humains, lorsqu’un virus est capable de muter et de se propager d’un humain à un autre d’une manière très efficace qui englobe essentiellement toute la planète. Et la science pandémique cherche à mieux comprendre ce phénomène de certaines façons.
Actuellement, beaucoup de mécanismes entrent en jeu, et un des projets auxquels je participe, la Lancet Commission on the Prevention of Viral Spillover, s’attarde à l’étape prédéterminée qui précède une pandémie sur le point de se concrétiser. Selon moi, une partie du problème avec l’accord sur les pandémies conclu hier réside dans toute l’attention portée sur la pandémie elle-même et non sur sa cause, c’est-à-dire la contagion virale. Mais la contagion virale n’est même pas la cause des pandémies, puisque pour qu’elle puisse se propager, d’autres facteurs doivent être présents et s’intensifier, comme la déforestation, qui provoquent un stress chez les animaux et affaiblissent leurs systèmes immunitaires, ce qui les empêche de combattre leurs propres virus. Cela se traduit par un empiétement sur les forêts faisant en sorte que les animaux sauvages se retrouvent à plus grande proximité du bétail et d’autres genres d’animaux que nous élevons pour nos propres besoins, en tant qu’humains, sans que cela profite aux animaux eux-mêmes, augmentant de ce fait les risques que se produisent des transmissions de ce genre. Il y a également nos modèles commerciaux de pratiques agricoles, qui rassemblent des milliers d’oiseaux dans le même secteur, ce qui augmente bien sûr le risque de transmission lorsque ces événements se produisent. En fin de compte, quand nous parlons de pandémie, nous parlons en fait de notre façon de prendre soin de nos relations, c’est-à-dire de nos relations avec les animaux et de nos relations avec la planète.
Le problème que je vois dans l’approche des pandémies, qui se résume souvent à une approche « Une seule santé », en prenant en considération la santé des animaux et les croisements avec les maladies infectieuses, réside dans le fait que nous avons tendance à aligner ces secteurs séparés : nous avons les humains à un endroit, les animaux à un autre et l’environnement à un troisième endroit. À mon avis, pour que la science pandémique avance dans la bonne direction, nous devons mettre fin au discours qui aligne ces secteurs soi-disant distincts de la santé humaine, de la santé animale et de la santé planétaire, et chercher plutôt à mieux cibler, à décrire et à opérationnaliser l’interrelation entre les systèmes en nous concentrant sur les relations au lieu de nous intéresser à des variables isolées. Et lorsque nous nous concentrons sur les relations entre les variables au lieu des variables elles-mêmes, c’est-à-dire chaque animal ou chaque humain, tout en incluant les systèmes de connaissances traditionnelles autochtones qui incarnent cette forme de science, nous avons naturellement une meilleure chance de composer avec les multiples crises, dont les pandémies, mais intégrons aussi la perte de biodiversité, qui alimente les pandémies, et même les changements climatiques.
Ainsi, le processus correspondant à ce que sont les implications causales ou les facteurs causaux des pandémies est toujours décrit comme étant une contagion virale, mais lorsqu’il existe en fait des problèmes fondamentaux découlant souvent du colonialisme, comme notre relation avec les animaux et la terre et notre traitement grâce à eux, cela alimente le profil de risque de pandémies que nous observons aujourd’hui.
Nicole Halbauer : Ouah! Je trouve vraiment intéressant que nous ne parlions pas davantage à propos de ce que vous dites à propos de la santé planétaire, de la déforestation, de l’empiètement, tous ces éléments coloniaux survenus dans notre environnement qui devraient faire partie intégrante de la trame quand il est question de pandémie. Au lieu de traiter les symptômes après leur apparition, interrogeons-nous sur les raisons pour lesquelles nous avons des pandémies. Je crois que le point de vue holistique que vous avancez est très solide et percutant, qui mériterait que les responsables des politiques y consacrent plus de temps. Je me demandais d’ailleurs si votre expérience ou vos connaissances scientifiques sont prises en considération lorsque les responsables des politiques fédérales réfléchissent sur la préparation et la riposte face aux pandémies.
Nicole Redvers : Oui, en effet. Selon moi, les travaux de la Lancet Commission auxquels je participe sont le fruit d’un consortium international de scientifiques et de gens, qui creusent cette question pour trouver comment prévenir une contagion virale, et une grande partie de la conversation portait sur les principaux catalyseurs, notamment la conservation, la façon dont nous traitons les animaux, les problèmes de déforestation et les changements climatiques, de même que nos relations, essentiellement, et les valeurs affichées dans notre façon d’établir des liens. J’espère qu’au bout du compte, les travaux permettront aux gouvernements d’y voir plus clair sur le fait que nous ne pouvons pas parler seulement de vaccination, de tests de dépistage, d’évaluation… nous devons d’abord reculer de quelques pas, ce qui sera plus rentable. Des données économiques précises montrent que des investissements dans la prévention primaire nous permettront de faire des économies plus tard. Mais comme nous le savons, tenter d’amener le gouvernement à investir dans la prévention, quel que soit le domaine, se révèle habituellement difficile en raison des cycles électoraux rapprochés; cependant, de tous les éléments dans lesquels il est important de consacrer des sommes préventives, gérer les principaux catalyseurs des pandémies est assurément l’un d’eux. En ce moment, le processus de planification des pandémies fait l’objet de peu de discussion, voire d’aucunes au Canada et, à mon avis, nous perdons la main sur cette question.
J’encouragerais donc les responsables des politiques fédérales à se tenir au courant des travaux de cette Lancet Commission, dont le rapport devrait paraître dans 6 à 12 mois, en même temps qu’un certain nombre d’articles. En fait, nous venons d’en publier un, il y a quelques jours, qui porte sur l’évaluation des politiques publiques pour la prévention des pandémies, qui se veut de nature mondiale. Une des grandes lacunes observées concernait l’absence totale d’implication et de mobilisation communautaires dans le cadre de l’évaluation des mises en œuvre stratégiques. Beaucoup de politiques sur les pandémies ont tendance à être des décisions prises à un niveau très élevé sans la participation des communautés. Puisque la conversation sur la contagion porte sur la connexion entre animaux sauvages et humains, il faudrait vraiment qu’elle comporte une plus grande participation des communautés et qu’elle leur permette de comprendre que les problèmes sont l’aboutissement de notre traitement de l’environnement et des animaux.
Nicole Halbauer : Comment s’appelle le rapport de Lancet?
Nicole Redvers : En fait, les commissions de Lancet sont financées par diverses entités, mais sont hébergées par le « Lancet Journal » et se concentrent sur différents sujets; celle-ci en particulier se concentre sur la prévention des contagions virales. Elle est appelée « Lancet Commission on Prevention of Viral Spillover » et a un site Web dans The Lancet qui présente quelques renseignements préliminaires. Nous avons publié quelques articles jusqu’à maintenant, mais le rapport en soi ne paraîtra que dans 6 à 12 mois environ.
Nicole Halbauer : C’est vraiment sensationnel. Les gens ont donc accès à quelques articles déjà publiés sur le site Web et devront attendre le rapport, auquel ils auront également accès. En ce qui concerne particulièrement nos dirigeants élus, nous devons savoir comment modifier et mettre en place les politiques, et attribuer des fonds pour gérer les principaux catalyseurs afin de n’être pas constamment prisonniers d’un cycle pandémique, à l’avenir.
Un des éléments que nous avons relevé lors de la dernière pandémie et qu’a mentionné un des présentateurs du webinaire auquel nous avons toutes deux pris part avait trait à certaines complications rencontrées chez les communautés des Premières Nations, inuites et métisses entourant la pandémie, et vous avez parlé de la participation des communautés. Je me demandais si nous avons reçu des commentaires sur les moyens d’accroître la consultation de nos communautés pour qu’elles aient davantage le sentiment de faire partie du processus. Parce que cette consultation est significative et convenable pour les communautés et nous permet de protéger notre environnement, nos communautés, notre santé, sans compter que nous pouvons aussi nous attaquer à ces principaux catalyseurs dont vous parlez. Parce que, à mon avis, le fait que ces grands catalyseurs ne soient pas liés aux pandémies est un point central, et nous devons transmettre ce genre de renseignements de façon à les faire entendre et à mettre en œuvre des actions à ce sujet. Qu’en pensez-vous?
Nicole Redvers : Tout à fait d’accord. Je crois qu’en définitive, il faut assurer une meilleure éducation communautaire autour de l’importance de la connexion entre la terre et la santé animale, et la santé des humains en général. Et cette condition s’amplifiera de plus en plus, même lors de crises comme les changements climatiques. Nous en avons un bon exemple, bien sûr, avec la fonte du pergélisol, qui présente une plus forte probabilité que des virus dormants surgissent de la glace et causent éventuellement des problèmes aux humains, sans parler des risques perçus par les organisations de personnes de la santé publique qui interagissent avec les animaux sauvages. Il s’agit à mon avis d’une question très délicate parce que beaucoup de conversations ont porté sur le fait que nous devons éviter le contact des personnes avec des animaux sauvages pour prévenir les pandémies. Mais il va de soi que dans nos communautés, nous savons depuis des milliers d’années comment interagir avec les animaux sauvages; nos gens doivent alors être attentifs au fait qu’il s’agit du genre de conversations tenues à l’échelle internationale. Nous devons veiller à être entendus pour que nos droits soient protégés et que le gouvernement du Canada ne se contente pas de suivre la politique internationale sans tenir compte des points de vue autochtones concernant nos interactions avec les animaux sauvages; nous devons aussi nous assurer que notre démarche axée sur les droits est considérée indépendamment de certaines autres politiques sur les animaux sauvages et sur l’agriculture commerciale qui pourraient être ou ne pas être adoptées après la parution de ce rapport pandémique maintenant adopté.
Il faut donc que les communautés bénéficient d’une démarche éducative axée sur les droits, et exposer clairement le fait que nos processus de pêche et de chasse n’ont aucun effet relativement à cette question. Ajoutons que la reconnaissance du fait que l’environnement est un grand catalyseur, compte tenu de notre relation avec lui, les peuples autochtones peuvent être ceux qui défendent l’environnement de cette manière et qui, à mon avis, peuvent instruire les gouvernements concernant ces connexions. Je crois que nous sommes capables de reconnaître et savons depuis des milliers d’années qu’une terre en bonne santé assure la santé de tous. Cela s’avère plus important dans le contexte de la planification et de la prévention des pandémies, et nous expose un autre angle de la santé publique, en plus de tous ceux liés à nos droits, pour revendiquer la santé des terres, la protection des forêts, les mouvements de restitution des terres, ce genre de choses. Et l’importance de la conservation et de l’intendance des terres autochtones pour la prévention des pandémies, dans ce contexte, est un outil sous-utilisé, selon moi, dont nos communautés autochtones pourraient arriver à tirer parti non seulement ici, au Canada, mais à de nombreux endroits dans le monde.
Nicole Halbauer : Madame Redvers, je pourrais vous écouter parler toute la journée. Vous mettez vraiment de l’avant toutes les notions que nous connaissons instinctivement dans nos communautés, et vous les présentez d’une manière qui s’inscrit également dans le paradigme académique occidental, de sorte que plus de personnes les comprennent. J’apprécie réellement tout cela. Je raffole de tout ce qui a trait aux droits, et le fait que vous avez dit qu’une terre en bonne santé assure la santé de tous, une manière concise d’exprimer cette valeur et cette interrelation, est à mes yeux d’une grande importance. Mais je me demande seulement, moi qui poursuis mon cheminement académique et qui suis convaincue que de nombreux autres seront sûrement intéressés, si vous pourriez suggérer deux ressources aux leaders de nos communautés (ceux de petites communautés locales), qu’ils pourraient se procurer dans leur librairie locale ou trouver en ligne. Avez-vous deux ouvrages à proposer comme base de lecture pour approfondir le sujet?
Nicole Redvers : Il existe un certain nombre d’angles différents sous lesquels, selon moi, chacun emprunte une avenue différente de revendication possible. Je vais donc m’en tenir à ce qui, à mon avis, pourrait se révéler utile pour que les communautés créent plus de synergie, et qui a recours au type de langage utilisé autour des tables provinciales, nationales et internationales, c’est-à-dire la terminologie appliquée à la santé planétaire. Il y a un article que nous avons rédigé, que j’avais remarqué au tout début, qui compare en quelque sorte la science occidentale à la science autochtone. Cet article en anglais s’intitule The determinants of planetary health : An Indigenous consensus perspective (page en anglais). J’aime cet article parce qu’il repose sur les voix de peuples autochtones du monde entier, mais les présente selon moi de façon très claire, se concentre sur les propos que j’ai entendus à maintes reprises dans les communautés comme étant des éléments clés à mettre en place pour la santé de la planète.
Prenons par exemple l’un d’entre eux, le respect de la femme, que nous avons perdu dans nos communautés. Avant la colonisation, la majorité des communautés du Canada étaient matriarcales, la désignation ancestrale de la personnalité juridique est une notion que nous n’avons pas considérée dans sa pleine mesure dans le contexte canadien, à mon avis, surtout en ce qui a trait à nos traités et à la possibilité de donner ou non des droits à la nature, dans le cadre des systèmes coloniaux, pour leur protection, malgré certaines limitations inhérentes. Quoi qu’il en soit, je pense que nous n’en parlons pas assez dans nos communautés. La compréhension de notre interdépendance humaine avec la nature, nous l’incarnons tous naturellement, mais comment s’y prendre pour la transmettre aux responsables des politiques en tant que prémisse des négociations? La manière dont l’article cadre la relation individuelle et communautaire, de même que notre gouvernance et nos lois, expose avec clarté comment cela perpétue la déconnexion avec la planète et les dommages qui sont causés à cette dernière.
Et puis finalement, vous savez qu’il met en évidence l’importance de la santé des Autochtones dans le contexte factuel que les peuples autochtones sont actuellement les gardiens de 80 % de la biodiversité restante de la planète, soit le tiers des forêts de peuplement mûr. Alors, si les peuples autochtones ont la santé et le bien-être, leurs cultures, leurs langues, leur souveraineté et leur autodétermination, ils sont en mesure de poursuivre l’intendance de 80 % de la biodiversité restante de la planète, soit le tiers des forêts de peuplement mûr, ce qui profite non seulement aux peuples autochtones, mais à tous. Lorsque les Autochtones sont en bonne santé et prennent soin de leurs terres – la planète entière est en bonne santé.
Je pense que cet article renferme beaucoup d’éléments à exploiter pour encadrer les raisons qui expliquent pourquoi il est important de faire ce que nous faisons, d’avoir du financement pour les programmes de guérison de la terre et d’avoir du financement pour les langues autochtones, qui constituent un autre déterminant de la santé présenté dans cet article.
C’est une des ressources qui me vient en tête et qui s’est révélée très utile dans les conversations que nous avons eues entourant ce sujet, partout dans le monde.
Nicole Halbauer : Puis-je vous poser quelques questions à propos de votre cheminement? Commençons par le commencement : comment avez-vous poursuivi vos études jusqu’au doctorat? Dites-m’en juste un peu sur votre parcours jusqu’au doctorat et sur l’assimilation de toutes ces connaissances. Ce que vous faites est tellement inspirant pour tellement de personnes, en plus d’avoir de grandes répercussions, mais vous restez si discrète à ce sujet.
Nicole Redvers : Ouais… en fait, je viens de petits endroits tout au nord, vraiment très au nord. Je plaisante tout le temps lorsque des personnes de London, en Ontario, me disent qu’elles viennent du nord alors que ce n’est qu’à deux heures à peine d’ici. Mais j’ai grandi sans jamais penser faire de longues études. Comme beaucoup d’entre nous, dans nos communautés, j’ai rencontré des conseillers d’orientation professionnelle qui m’ont poussée sur des voies extrascolaires parce que je pense qu’ils ne croyaient pas en mes capacités, comme la plupart des enfants, n’est-ce pas? Et j’ai obtenu mon diplôme sans avoir suivi de cours de mathématiques, par exemple. À mi-chemin de mon parcours universitaire, je me suis retrouvée dans le mauvais cours; je faisais des études en kinésiologie parce que dans le Nord, tout ce que nous faisons, c’est du sport, alors c’est tout ce que j’avais envisagé de faire. J’ai donc assisté à un cours sur la médecine naturopathique. C’était la première fois que j’entendais parler de médecine naturopathique en général, et j’ai été plutôt stupéfaite d’apprendre qu’il existait une profession dans laquelle je pouvais étudier les plantes, en plus de recevoir une formation médicale. J’ai décidé de changer de concentration dès le lendemain. Mais j’ai réalisé que ce n’était pas si facile parce que je n’avais suivi aucun des programmes académiques, dans mon école secondaire, qui m’aurait permis de remplir les conditions préalables aux cours que je devais suivre dans ce programme.
J’ai dû me mettre à niveau avec les mathématiques de 12e année au collège en plus de toute ma charge de cours à l’université parce qu’on ne m’avait jamais poussée à le faire. À ce moment-là, je me suis sentie très frustrée, en fait, parce que j’ai réalisé que j’aurais probablement pu le faire au secondaire si quelqu’un m’avait dit que c’était possible. Mais nos conseillers d’orientation professionnelle pensaient peut-être que nous étions Autochtones et pas assez intelligents pour faire ce genre de travail. En tout cas, j’ai persévéré et suivi les cours du secondaire en me mettant à jour tout en poursuivant mon programme universitaire, ce qui m’a permis de m’inscrire au programme.
Je suis devenue docteure en naturopathie et j’ai travaillé dans ma région natale environ 11 ans en exploitant une clinique intégrative au nord de Yellowknife. Après environ 5 ans, j’ai commencé à admettre que beaucoup de nos problèmes de santé sont difficiles à régler dans les limites d’une salle d’examen clinique, et que nos problèmes sont en majorité de nature structurale et causés par une forte marginalisation structurale, le racisme et tous ces composants qu’il fallait aborder dans une plus grande perspective pour s’y attaquer.
À ce moment-là, nous avons rencontré les Aînés de ma région et avons créé en 2017 un organisme appelé Arctic Indigenous Wellness Foundation afin de nous permettre de mettre sur pied ce qui, je crois, aura été le premier programme urbain de guérison fondée sur la terre. Il existait beaucoup de programmes de guérison fondée sur la terre, mais nous voulions cibler un espace urbain parce qu’un grand nombre de nos proches, particulièrement sans domicile, n’avaient pas toujours les conditions ou les capacités nécessaires pour se rendre très facilement sur les terres, et nous voulions que la terre vienne à eux. Nous avons donc créé le programme, et nous avons offert des services de guérison traditionnelle et de consultation traditionnelle, tous prodigués par des Aînés et des Détenteurs du savoir de notre région et, petit à petit, nous avons mis sur pied des programmes qui ciblent, là encore, ceux qui ne viendraient pas dans un cabinet, dans une clinique, ou dans un certain lieu, mais se rendraient plus volontiers dans une tente ou un tipi au milieu de la nature pour recevoir les services de cette manière.
Cela m’a vraiment ouvert les yeux sur l’importance des méthodes que nous employons pour élaborer des programmes de santé publique et de prévention. Ce programme est en place depuis 8 ans, maintenant. Il est toujours ouvert aujourd’hui et offre des services toute l’année. Il existe une jolie vidéo en anglais que les gens peuvent visionner sur YouTube, intitulée « Healing Hearts ». Ils doivent taper « Healing Hearts », virgule « Redvers », ce qui les mènera à une petite vidéo montrant le travail effectué dans ce camp. Il s’agit sans doute d’une des choses dont je suis la plus fière, pas à cause de moi ou de mon travail, mais parce qu’il est le fruit d’un ensemble d’efforts collectifs. Et de réaliser que tout ne revient pas à la création de solutions dans nos communautés, que parfois il faut créer l’espace et dans cet espace enfin créé, les solutions surgissent.
Pour être honnête, ce qui m’a vraiment motivée est le passage dans les espaces universitaires, moi qui n’avais jamais imaginé, dans 100 ans, me retrouver dans une université en raison des problèmes de confiance et de la vision que nous avons des institutions. Il y avait un seul programme aux États-Unis qui devait élaborer un tout premier programme de doctorat en santé des Autochtones, et rassembler dans cette université un groupe de fournisseurs autochtones, de professionnels de la santé et de chercheurs; c’était trop alléchant pour ne pas faire partie de ce programme et pouvoir le façonner de manière très « décoloniale ». Il faisait office de tremplin vers une autre sorte d’espace au sein des soins cliniques. J’ai perçu très rapidement la possibilité de tirer définitivement profit des institutions et de servir de tampon en procurant des ressources aux communautés, en ancrant les ressources, tout en étant capable de transmettre des connaissances sur certains problèmes communautaires dans ces espaces plus vastes, ce que je n’aurais jamais pu faire depuis ma clinique à Yellowknife.
Nicole Halbauer : Que c’est inspirant! Je suis dans l’administration de la santé depuis les années 1990 et je m’étonne de constater à quel point tout a changé, mais aussi de l’ancrage encore marqué dans d’anciennes méthodes coloniales qui continuent de causer des dommages. Il est toujours rafraîchissant d’entendre que des initiatives ont duré 8 ans et apporté des changements impressionnants dans la vie des membres de nos communautés. C’est fascinant.
J’aurais juste une toute dernière question pour vous, si ça vous convient : pour nous tous, les enfants qui avons suivi un programme d’études de base pour l’obtention d’un diplôme contrairement au cheminement scolaire des universitaires et qui doivent maintenant trouver un moyen d’entrer à l’université, parce que nous avons compris que nous sommes aussi importants et intelligents que les autres enfants de la classe, quel conseil donneriez-vous à ces personnes qui font leur entrée dans le monde des études, dans le monde de la recherche, et qui retournent dans ces mêmes universités des années 1990 et 2000, qui érigeaient de nombreux obstacles pour nous tenir à l’écart?
Nicole Redvers : Oui, c’est un sujet qui me passionne vraiment, puisque j’ai traversé cette épreuve en étant probablement qualifiée d’« élève médiocre », même si je n’ai pas eu d’échecs. Je me suis débrouillée, mais on ne m’a pas poussée ou donné la possibilité de comprendre que j’avais de la valeur dans la façon dont j’ai été élevée. Et j’en ai la preuve maintenant que j’ai pu avancer, devenir docteure en naturopathie, en plus d’avoir obtenu une maîtrise, et un doctorat en philosophie de l’Université d’Oxford. Je n’ai jamais pensé avoir l’intelligence ou la capacité de faire tout cela, ce n’était même pas dans mon état d’esprit. Je ne me donne aucunement en exemple, je montre seulement que malgré ce que disent les autres ou même ce que nous pensons de nous-mêmes, nous avons un immense potentiel, et nos connaissances sont estimées lorsque nous les appliquons de la bonne façon.
J’ai toujours considéré que les institutions n’étaient pas des endroits où se laisser entraîner ou se conformer à leurs manières; un des meilleurs moyens pour changer les systèmes consiste à les comprendre mieux qu’ils se comprennent eux-mêmes. C’est ainsi que j’ai toujours abordé l’université, comme un système que je voulais connaître mieux que lui-même pour savoir comment le changer. Et lorsque je suis un cours, si je ne suis pas d’accord avec son contenu, je me force à le comprendre pour savoir comment le changer plus tard. Cela m’a vraiment aidé à me mettre en contexte. Si les programmes ne convenaient pas, s’ils étaient racistes, si les professeurs n’étaient pas encourageants, s’ils étaient vraiment ignorants concernant les façons autochtones, je prenais cela comme une leçon : ce sont ce genre de personnes, ce genre de choses auxquelles nous sommes confrontés. Comment puis-je en apprendre autant que possible à leur sujet pour, là encore, savoir comment travailler avec eux ou changer les systèmes, parce qu’il est vraiment difficile de changer des systèmes sans les comprendre?
Il y a un intérêt, selon moi, à prendre ce temps, malgré les frustrations, en ayant conscience que ce ne sont pas nos systèmes et que c’est correct qu’ils ne le soient pas, mais notre façon de les utiliser, d’en tirer parti, de s’en servir pour faire le bien et de nous permettre de vraiment réfléchir aux différences qui existent entre les façons d’être un non-Autochtone et un Autochtone. Et faire preuve de créativité pour relier les ensembles de ressources médicales entre les lieux non autochtones et autochtones, parce qu’en certains points, il est précieux de disposer de différentes interprétations du monde, sans pour autant s’y attacher ou leur accorder une valeur émotionnelle, et en demeurant des Autochtones pendant que nous avançons à tout prix, ce qui constitue selon moi une tactique de survie.
Nicole Halbauer : Exactement. Je me sens sincèrement honorée d’avoir pu avoir cette conversation avec vous. Merci infiniment. T'oyaxsut 'nüün, je suis si privilégiée d’avoir pu passer plus de temps à vous parler. Je vous remercie infiniment d’avoir participé à ce balado, madame Redvers. J’encourage tous les auditeurs du balado à consulter les Déterminants de la santé planétaire – pourriez-vous nous rappeler le nom du site Web?
Nicole Redvers : Oui. C’est simplement « The Lancet ». Mais si vous tapez « Determinants of planetary health » virgule « Redvers », en anglais, vous serez sans doute dirigés vers le site.
Nicole Redvers : Je vous prie donc, chers auditeurs, d’aller le consulter. Pour écouter plus de balados de cette série, allez aux Voix du terrain sur le site Web du Centre de collaboration nationale de la santé autochtone (CCNSA), à l’adresse ccnsa.ca. La musique de ce balado est l’œuvre de Blue Dot Sessions. Elle est disponible sous une licence Creative Commons. Renseignez-vous à www.sessions.blue.
Merci encore, madame Redvers. Vous avez été très inspirante, et je me sens prête à sortir et à poursuivre le travail qui doit se faire tout en conservant mon identité Ts’msyen. Merci, t'oyaxsut 'nüün.
Nicole Redvers : Mussi Cho.
– Musique –