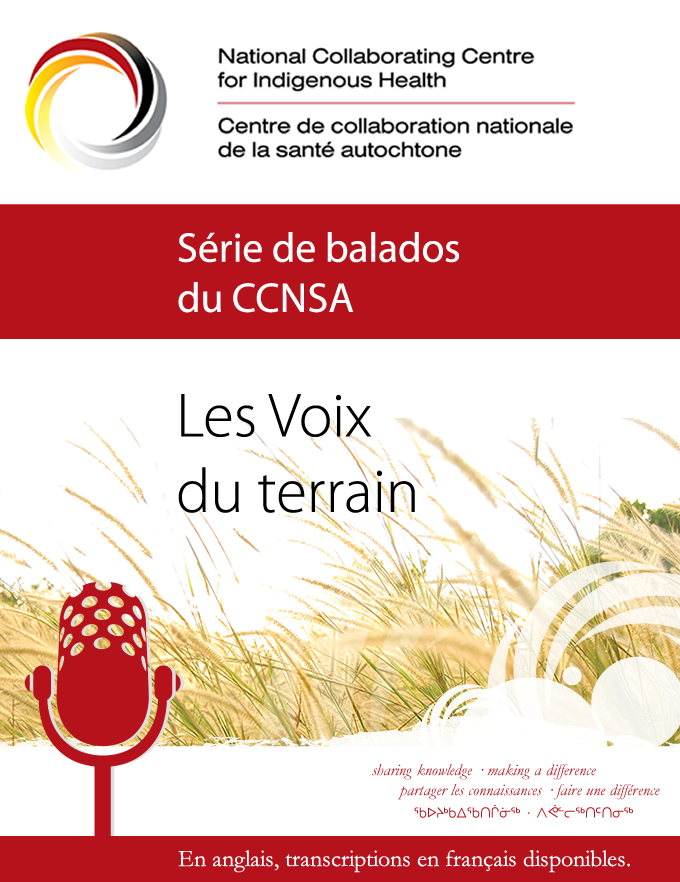 Série de balados Les Voix du terrain
Série de balados Les Voix du terrain
Les Voix du terrain
Bienvenue aux Voix du terrain, une série de balados produite par le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone (CCNSA). Le CCNSA met l’accent sur la recherche innovante et les initiatives communautaires visant à promouvoir la santé et le bien-être des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada.
Épisode 32 – Désincarcération et santé : éliminer les barreaux pour un changement systémique –
Partie 2 : Justin Tetrault, Ph. D.
Description
Désincarcération et santé : éliminer les barreaux pour un changement systémique est une minisérie dans le cadre des Voix du terrain. Elle a inspiré le rapport du CCNSA Derrière les barreaux : la surincarcération des Autochtones dans le système de justice pénale canadien, ses conséquences sur la santé et les possibilités de désincarcération. Ce rapport fait état de la crise de santé publique découlant de la surincarcération de membres des Premières Nations, d’Inuits et de Métis dans le système pénal canadien et explore des avenues pour la désincarcération grâce à des solutions de recherche fondées sur la justice communautaire, notamment des programmes de déjudiciarisation, des tribunaux autochtones et des pavillons de ressourcement dirigés par des Autochtones. La surincarcération a à la fois des effets immédiats et des répercussions négatives à long terme sur la santé et est un déterminant de la santé. Cette minisérie permet d’entendre des experts dans le domaine sur les réalités et les bienfaits des solutions de rechange qu’apporte la justice communautaire, leur lien avec la santé et ce qui serait nécessaire pour amener des changements systémiques et remédier aux injustices actuelles, qui se traduisent par une surincarcération des Autochtones à travers le pays.
Désincarcération et santé : éliminer les barreaux pour un changement systémique – Partie 2 : Justin Tetrault, Ph. D.. Dans cet épisode, nous entendons Justin Tetrault, docteur en sociologie, criminologue métis et professeur adjoint de sociologie à l’Université de l’Alberta. Nous découvrons les recherches de Justin Tetrault en milieu carcéral et l’importance des programmes autochtones dans les prisons et pénitenciers, ainsi que les enjeux sérieux touchant la santé et le bien-être des autochtones en prison. Nous en apprenons également davantage sur ce qui est nécessaire et ce qui est fait pour susciter un changement de politique et soutenir l’autodétermination des peuples autochtones en matière de justice et de guérison.
Écouter sur SoundCloud (en anglais)
Lire la transcription française du balado ci-dessous ou télécharger la transcription (PDF) ici
Télécharger une liste de ressources liées au balado (PDF)
Biographies

Justin Tetrault, docteur en sociologie, est professeur adjoint de sociologie au campus Augustana de l’Université de l’Alberta. Ses recherches portent sur les mouvements sociaux, la théorie politique, les méthodes qualitatives, la décolonisation et les prisons. Il est également chercheur principal et gestionnaire de projet du University of Alberta Prison Project (projet de l’Université de l’Alberta sur les prisons et pénitenciers), une étude pluriannuelle sur les expériences de vie des détenus. Dans le cadre de ce travail, il a publié des articles sur les programmes indigénisés et les relations raciales dans les prisons de l’Ouest canadien. Ses recherches actuelles portent sur les obstacles auxquels les peuples autochtones sont confrontés lors de leur libération de prison. Justin Tetrault étudie également le nationalisme canadien et a publié des articles sur l’extrémisme de droite et les crimes haineux. Il est un fier citoyen de la Nation Métisse du Manitoba.

Andrea Menard – Je suis une personne métisse associée au gouvernement métis Otipemisiwak et je travaille sur le territoire visé par le Traité no 6 à amiskwacîwâskahikan (Edmonton). Ma famille est originaire de la colonie de la rivière Rouge, maintenant dissoute, dans le territoire du Traité no 1. Notre lignée métisse porte les noms de famille Bruneau, Carrière et Larocque.
Je suis honorée d’avoir été nommée parmi les cinq avocats les plus influents de 2023 par le magazine CIO Times et parmi les 25 avocats les plus influents de 2022 par Canadian Lawyer. Ces distinctions témoignent de mon profond engagement à collaborer avec les nations autochtones dans le cadre des traités 4, 6, 7, 8 et 10, notamment des collaborations avec le gouvernement métis Otipemisiwak.
Mon parcours personnel comme personne métisse oriente mon ambition de réformer les politiques pédagogiques et juridiques en milieu de travail grâce à l’inclusion des lois autochtones, et il est enrichi par mes études de doctorat en théorie de la dominance sociale et en pluralisme juridique à l’Université Royal Roads dans le programme de doctorat en sciences sociales.
En tant que chargée de cours de droit à la Faculté de droit de l’Université de Calgary et à la Osgoode Hall Law School, je développe et donne des cours novateurs tels que « Reconciliation and Lawyers » (réconciliation et avocats) (LAW 693) et « In Search of Reconciliation Through Dispute Resolution » (à la recherche de la réconciliation par le règlement des différends) (ALDR 6305). De plus, je suis conseillère pédagogique au développement pour l’indigénisation des programmes et des pédagogies au Centre for Teaching and Learning de l’Université de l’Alberta, le centre d’enseignement et d’apprentissage.
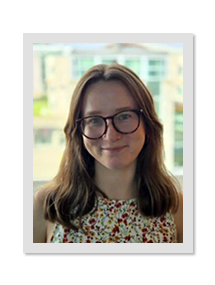
Denise Webb est associée de recherche au Centre de collaboration nationale de la santé autochtone. Elle est titulaire d’une maîtrise en sciences de la recherche sur les services de santé, avec une spécialisation en politique de santé et en santé autochtone, de l’Institut des politiques, de la gestion et de l’évaluation de la santé de l’Université de Toronto. Ses recherches portent sur l’intersection et la relation entre les politiques de santé et la santé publique des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Denise Webb est d’origine irlandaise et écossaise et est une aspirante alliée, travaillant à orienter les efforts de décolonisation des systèmes de santé et de la recherche sur les politiques.
Transcription
Denise Webb : Bienvenue aux Voix du terrain, une série de balados produite par le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, le CCNSA. Le Centre s’intéresse à la recherche novatrice et aux initiatives communautaires qui visent à promouvoir la santé et le bien-être des populations des Premières Nations, des Inuits et des Métis partout au Canada.
– Musique –
Bonjour et bienvenue à Désincarcération et santé : éliminer les barreaux pour un changement systémiqueune minisérie dans le cadre de Voix du terrain. Je m’appelle Denise Webb. Je suis descendante de colons irlandais et écossais et je vis en tant qu’invitée sur le territoire traditionnel non cédé des Lheidli T’enneh, au nord de la Colombie-Britannique. Je suis associée de recherche au Centre de collaboration nationale de la santé autochtone et je coanimerai cette minisérie en compagnie d’Andrea Menard.
Andrea Menard : Bonjour, tânsi, hello tout le monde. Et merci, Denise. Je suis métisse et juriste de profession, anticolonialiste et originaire de la colonie de la rivière Rouge, où les noms de mes familles sont Bruneau, Carrière et LaRocque. Je suis également titulaire d’une carte de membre du gouvernement métis d’Otipemisiwak, le gouvernement de la nation métisse de l’Alberta. J’habite présentement sur le territoire non cédé du Traité 6 et sur les terres de la région de la patrie métisse.
Je possède plus de 20 années d’expérience en droit et dans les secteurs gouvernementaux et juridiques des organismes sans but lucratif et du droit universitaire et réglementaire. J’ai tissé des liens dans tout le territoire maintenant connu sous le nom de Canada avec des Autochtones et des nations et des organisations autochtones, de même qu’avec des professionnels et des partenaires universitaires non autochtones avec qui je collabore dans le cadre de bon nombre de programmes et d’initiatives de décolonisation et de réconciliation.
Denise Webb : Merci, Andrea. Désincarcération et santé : éliminer les barreaux pour un changement systémique est une minisérie inspirée d’un rapport que j’ai rédigé et qui a été publié en 2024 par le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone sous le titre Derrière les barreaux – La surincarcération des Autochtones dans le système de justice pénale canadien, ses conséquences sur la santé et les possibilités de décarcération. Ce rapport visait à contribuer à l’information sur la crise de santé publique que constitue la surincarcération des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans le système pénal canadien. Ce rapport explore aussi des avenues pour la désincarcération grâce à des solutions de rechange fondées sur la justice communautaire, notamment des programmes de déjudiciarisation, des tribunaux autochtones et des pavillons de ressourcement dirigés par des Autochtones.
La surincarcération a des effets négatifs immédiats et à plus long terme sur la santé et constitue un déterminant de la santé. Cette minisérie de balados offre une occasion d’écouter des experts de la question et des personnes ayant de l’expérience de travail dans le système pénal et d’en apprendre un peu plus sur cette question, sur les changements qui sont nécessaires et sur la façon dont les lois et les principes juridiques autochtones peuvent être respectés et maintenus en vue de favoriser l’émergence d’un système de justice distinct, dirigé par les Autochtones.
Je suis incroyablement reconnaissante à Andrea, qui a gracieusement accepté de soutenir le CCNSA en dirigeant et orientant les travaux pour la réalisation de cette minisérie; en partageant ses connaissances, son expertise juridique et sa passion pour cette question. C’est un honneur de vous voir avec nous, Andrea.
Andrea Menard : Aucun problème, Denise. C’est un plaisir pour moi d’être ici et de coanimer avec vous, et d’avoir l’occasion de mener ensemble des entrevues avec des personnes formidables qui travaillaient à éliminer les obstacles systémiques et à entraîner des changements qui transforment le domaine pénal, changements qui ne sont pas toujours bien compris ou encore connus pour le moment.
Alors, j’apprécie beaucoup l’espace que le CCNSA a offert à cet important balado. Mon objectif est de créer une dynamique en apprenant ce que font les autres et de faire en sorte que les choses avancent de la bonne façon.
– Musique –
Denise Webb : Dans l’épisode d’aujourd’hui, nous entendrons le Dr Justin Tetrault, criminologue, Métis et professeur adjoint de sociologie et de criminologie à l’Université de l’Alberta. Nous en apprendrons plus concernant les travaux de recherche du Dr Tetrault sur les environnements carcéraux et l’importance des programmes destinés aux Autochtones dans les prisons, ainsi que sur les grands enjeux touchant le bien-être des détenus autochtones. Nous nous renseignerons aussi sur les besoins et sur ce qui est fait pour entraîner des changements dans les politiques et ouvrir la voie à l’autodétermination des Autochtones en matière de justice et de guérison.
Andrea Menard : Alors bienvenue, Dr Tetrault. Pourriez-vous vous présenter à notre auditoire et nous en dire un peu plus sur votre parcours?
Justin Tetrault : Bien sûr, oui. Bonjour tout le monde. Je suis professeur adjoint de sociologie et de criminologie au campus Augustana de l’Université de l’Alberta. Et je suppose que je suis un nouveau professeur; j’ai été embauché il y a quelques années et je vais bientôt avoir ma permanence, je pense. En fait, j’étudie, dans une plus large mesure, les prisons et les mouvements sociaux; je travaille aussi sur le nationalisme canadien et ce qu’il signifie. Enfin, comme nous le verrons aujourd’hui, je réalise des travaux de recherche sur les questions autochtones, et c’est sans doute sur cet aspect de mes travaux que portera notre entretien d’aujourd’hui.
Je suis Métis de Red River, originaire du territoire du Traité no 1 à Winnipeg, au Manitoba. Mon père, alors qu’il était enfant, a été parmi les victimes de la rafle des années soixante. Si des gens de notre auditoire ne savent pas exactement de quoi il s’agit, c’est en fait le moment où le gouvernement canadien a apporté des modifications à sa politique des services à l’enfance, dans les années 1950, dans le cadre de ses efforts pour assimiler les enfants autochtones à la culture eurocanadienne, la « culture des Blancs ». L’idée consistait, en gros, à trouver le meilleur moyen d’assimiler ces enfants. On a alors dit qu’on devait « éloigner les enfants de leur famille autochtone pendant qu’ils étaient jeunes, les confier aux services de protection de l’enfance, puis les transférer dans des familles blanches. » Donc, des travailleurs sociaux se sont présentés à la ferme familiale de mon père et l’ont enlevé, avec ses frères et sœurs, avant de les séparer et de les répartir un peu partout à travers le pays.
Je ne connais donc pas la plupart des membres de la famille de mon père. Je sais toutefois ce qui est arrivé à certains d’entre eux. Je sais par exemple que l’un des enfants de mon père a été déplacé vers une communauté éloignée du Nord, où il a été forcé de s’occuper d’une bande d’enfants qui ont ensuite mis fin à leur vie. D’autres membres de ma famille se sont retrouvés en prison, ont eu des problèmes de toxicomanie, ainsi de suite.
Je parle de tout cela parce que c’est pertinent pour notre entretien d’aujourd’hui, car ce genre de choses est malheureusement assez courant chez les populations et dans les familles autochtones. On parle ici de la façon dont ces politiques ont concrètement et effectivement marqué leur vie. Comme nous le verrons, nous avons interviewé de nombreux détenus qui avaient été confiés aux services à l’enfance et ont vécu des expériences similaires.
Denise Webb : Merci, Justin. Donc, pourriez-vous nous en dire plus sur vos travaux de recherche et sur ce que vous avez fait à la suite des entrevues réalisées auprès de détenus autochtones, et sur ce que l’on connaît sous le nom de Prison Project [projet sur les prisons] de l’Université de l’Alberta? Je me demande si vous pourriez nous renseigner davantage sur votre rôle dans le cadre de ce projet et des travaux de recherche que vous réalisez.
Justin Tetrault : Oui, bien sûr. Alors, cela fait partie d’une plus grande équipe. Nous réalisons ces travaux depuis 2016. Lorsque j’ai commencé à travailler sur le Prison Project de l’Université de l’Alberta, j’étais en fait étudiant de cycle supérieur et doctorant. Je travaillais de mon côté sur ma dissertation portant sur l’extrémisme politique au Canada lorsque mon superviseur, le Dr Kevin Haggerty, et sa collègue la Dre Sandra Bucerius – qui est maintenant une collègue et une amie – amorçaient cette étude, cette immense étude sur les prisons, et bref, ils m’ont demandé si je souhaitais me joindre à eux en tant qu’étudiant de cycle supérieur, puisque j’avais un intérêt pour les enjeux de race, les questions autochtones et l’extrémisme. Ils m’ont dit, en gros, « Nous irons dans les prisons et nous réaliserons des entrevues avec des gens, des détenus et du personnel et des personnes incarcérées, et cela n’a jamais été fait auparavant, du moins pas à cette envergure à travers le Canada. Nous ne savons pas vraiment à quoi nous attendre une fois à l’intérieur et nous voulons tout savoir. Veux-tu te joindre à nous et faire quelques entrevues? » Et moi, l’étudiant de cycle supérieur, les yeux remplis d’étoiles, j’ai tout de suite répondu : « Oui, bien sûr, je veux le faire. » – évidemment, j’ai dit : « Oui, cela m’intéresserait vraiment. »
En résumé, nous avons finalement interviewé quelque 800 détenus, hommes et femmes, et plus de 100 membres du personnel, je crois, entre 2016 et 2020. La pandémie a en quelque sorte mis un frein à nos travaux, et je n’ai pas à aborder la question de la pandémie, mais en gros, nous poursuivons ce travail sur la réinsertion, un aspect que nous pourrons peut-être aborder vers la fin de notre entretien. Donc, pour l’étude initiale – celle de 2016 à 2020 – mon travail, ce que je devais faire de mon côté, portait sur les personnes incarcérées, les détenus et les enjeux autochtones en particulier, et très franchement, nous avons été épatés par l’enthousiasme qu’a suscité notre étude chez les détenus.
Ce que nous avons fait, essentiellement, est de nous rendre dans les prisons, où nous avons installé des feuilles d’inscription dans les unités, et les gens n’avaient qu’à s’inscrire. Les entrevues duraient environ 90 minutes. […] Je me souviens qu’un jour, j’ai réalisé une entrevue de deux jours avec un type, à raison de trois heures par jour. Nous avons interviewé tous les genres de personnes que vous pourriez imaginer, accusés de tous les crimes auxquels vous pourriez penser, et nous leur avons posé toutes les questions imaginables; nous avons discuté des gangs, de la drogue, de la nourriture, de l’ennui, de la santé mentale et physique, comme nous le verrons, et nous avons aussi posé des questions à propos du personnel, des programmes, et de la libération.
Et jusqu’à maintenant, j’ai publié sur les gangs racisés dans les prisons de l’ouest du Canada et plus récemment sur l’expérience des programmes culturels vécue par les détenus, programmes mis en place il y a quelques années ou plus récemment. Donc, nous avons discuté des ressources culturelles dans les prisons, un point que nous allons aborder tout à l’heure. Il est également important de mentionner la surreprésentation des Autochtones dans les prisons. Les Autochtones ne représentent que 5 % de la population générale du Canada, mais forment environ 30 % de la population carcérale. Chez les femmes, c’est la moitié dans le système carcéral fédéral; en effet, la moitié des femmes incarcérées dans des établissements fédéraux sont autochtones – une statistique renversante. Et le tout se reflète aussi dans notre échantillon, c’est-à-dire dans notre bassin de participants. Donc 40 % de nos participants environ se sont identifiés comme Autochtones, et je crois que 70 % des femmes étaient autochtones – oui, soixante-dix.
Et la question que notre auditoire se pose probablement est : « Pourquoi cette immense disparité? » Nous pouvons en trouver la cause directement dans les politiques coloniales du Canada. Pendant la majeure partie de l’histoire du Canada, l’objectif explicite du gouvernement canadien était d’anéantir les cultures autochtones et d’affaiblir les communautés à l’aide de diverses politiques, notamment la relocalisation forcée dans des réserves, au moyen de la Loi sur les Indiens – la Loi sur les Indiens est cet instrument législatif ouvertement raciste par lequel les groupes de Premières Nations ont été forcés de s’inscrire, et qui définissait illégalement ce qu’était un « Indien ». Cette loi a retiré tout contrôle et toute souveraineté aux communautés de Premières Nations. Le gouvernement a aussi établi un système de laissez-passer pour empêcher les Autochtones de quitter les réserves et a créé des pensionnats – je suis certain que les gens en ont entendu parler – afin d’assimiler les jeunes à la culture blanche et d’annihiler les familles et les cultures. Et avec la rafle des années soixante, que mon père et bien d’autres personnes ont subie, on retirait les enfants de leurs familles. Aujourd’hui, en raison de ces politiques de rafle, entre autres choses, 50 % des enfants confiés aux services sociaux sont autochtones.
Donc, quel est le rapport qu’a tout cela avec la criminalité? Eh bien, on dit souvent que les gens choisissent de commettre des actes criminels, mais nos choix dépendent toujours des contextes dans lesquels on se retrouve ou de l’environnement dans lequel nous vivons. Les Autochtones sont tout simplement bien plus susceptibles que le Canadien moyen de vivre dans des conditions difficiles, plus stressantes, pour les raisons historiques que j’ai nommées rapidement. Et cela vaut d’être mentionné. Donc, les Autochtones, dans l’ensemble, courent plus de risques de vivre dans une pauvreté extrême ou d’être en situation d’itinérance. La moitié des enfants autochtones vivent dans la pauvreté. Les Autochtones courent aussi plus de risques d’avoir des problèmes de santé mentale et, parallèlement, de consommer, dans certains cas, des substances psychoactives. Ensemble, tous ces facteurs peuvent mener à des comportements criminels et faire en sorte que l’on entre dans le système. Ces politiques, qui ont été conçues pour détruire les familles, mettent aussi en péril la santé mentale, les cultures, et ainsi de suite.
Il importe aussi de mentionner que presque toutes les personnes que nous avons interviewées ont elles aussi été victimes de crimes avec violence. On pense souvent aux criminels comme à des « méchants » qui commettent des actes criminels, mais il s’agit la plupart du temps de personnes extrêmement marginalisées – pas la plupart du temps, mais très souvent, il s’agit de personnes très marginalisées qui sont elles-mêmes victimes de violence et aussi de violence sexuelle. Et c’est ce qui ressort de nos statistiques.
Nous avons aussi réalisé des sondages de victimisation auprès de nos participants. Ainsi, après avoir parlé avec eux aussi longtemps qu’ils le voulaient, nous nous sommes penchés sur leurs parcours et sur certaines choses qui leur étaient arrivées ou non, puis nous avons recueilli des renseignements de nature démographique. Nous voulions notamment comprendre les antécédents de ces personnes à titre de victimes : « Avez-vous déjà été victime d’un crime violent? Est-ce arrivé souvent? » Et nous avons constaté que chez les Autochtones, et dans l’ensemble, la proportion de victimes d’actes violents était très élevée. Je crois que 80 % de notre échantillon avait été victime d’actes de violence à un moment ou un autre de leur vie, et cette proportion était encore plus élevée et ces actes encore plus fréquents chez les Autochtones. La violence survenait aussi à un plus jeune âge chez ce segment de nos participants.
Je m’écarte un peu du sujet, mais c’est en quelque sorte le fondement de mes travaux des dix dernières années, au cours desquels je me suis concentré sur ce sujet. Ce n’est que tout récemment que nos travaux de recherche – étant donné le processus de publication qui est plutôt lent – ont commencé à être publiés et révèlent ce que nous avons constaté durant toutes
ces années.
Denise Webb : Vous venez tout juste de mentionner qu’étonnamment, la participation à l’étude a suscité un grand enthousiasme. Je me demande s’il y avait, dans l’étude, un élément vous permettant de comprendre la raison de cet engouement. Était-ce parce que les gens voulaient que leur histoire soit entendue, ou peut-être tout simplement parce que cela leur donnait quelque chose à faire? Pourriez-vous, si possible, nous mettre un peu plus en contexte?
Justin Tetrault : Bien sûr. En fait, cela s’explique par ces deux raisons – par toutes ces raisons. Je m’apprêtais à aborder le tout avec la santé, mais l’ennui que ressentent ces personnes est immense. Ce n’est pas la seule raison, mais l’ennui apparaît comme un facteur très important.
Pensez-y. Vous irez en prison demain, et il n’y a pas beaucoup de programmes disponibles. Il y a un téléviseur dans l’unité, et vous pouvez regarder la télé quelques heures par jour. Vous traînez. Il n’y a véritablement pas grand-chose à faire, alors la moindre chose qui arrive dans une unité, à tout le moins dans les prisons où nous sommes allés, devient quelque chose de très excitant. Les gens se disent : « Oh, des gens qui viennent ici pour nous parler… Je veux m’inscrire à ce projet. » Le désir est grand, et les personnes que nous avons interviewées voyaient notre projet presque comme un programme. Comme si un nouveau programme était mis sur pied qui permettait de parler à quelqu’un. C’est très excitant pour, encore une fois, les personnes qui n’ont accès à aucun programme, car les prisons n’offrent pas de ressources en santé mentale – à tout le moins, pas de ressources vraiment solides ou de soutien dans une plus large mesure – alors tout ce qui se présente pour pouvoir sortir de son unité ou parler à quelqu’un et ne pas avoir à regarder constamment les mêmes murs et qui permet d’aller dans une pièce différente, ça aussi, il faut y penser. Vous êtes en prison toute la journée, dans la même pièce toute la journée. Ça fait du bien de voir de nouveaux visages, d’aller à des endroits différents. C’est tout simplement une tendance naturelle pour les êtres humains que d’échapper à l’enfermement dans une certaine mesure et de vivre quelque chose de différent.
Cela fait donc partie de la dynamique de nos travaux. Et comme vous le mentionniez, plusieurs de ces personnes – nous avons eu surtout des entretiens avec des hommes, mais avec des femmes aussi – nous avons réalisé beaucoup d’entrevues où les hommes et les femmes également nous disaient : « On ne m’a jamais demandé cela auparavant. Jamais personne ne m’a demandé d’où je venais. », ou même : « Personne ne m’a jamais posé de questions à propos de ma famille. » ou bien, « On ne m’a jamais demandé ce que je pensais de la prison. » ou encore, « Personne ne m’a jamais demandé si j’aimais la nourriture que l’on servait ici. » […] Nous avons posé des questions à ces sujets – « Personne ne m’a jamais demandé ce que je pensais du personnel. »
Nous avons donc reçu de nombreux commentaires positifs, simplement parce que les gens voulaient se confier, ce qui est une tendance naturelle de tout être humain. Par exemple : « Je veux parler de moi et de mes expériences. Je vis une situation incroyablement difficile. » C’est un endroit horrible, n’est-ce pas? C’est une prison. Cela permet aux gens de se libérer, et il y a un aspect thérapeutique associé au fait de pouvoir dire qu’on a eu une vraiment mauvaise semaine, qu’une chose a été très difficile, ou qu’il est difficile de ne pas penser à ses enfants. […] Il est difficile de généraliser à ce sujet, car nous avons discuté avec un éventail de personnes si varié, qui nous ont parlé d’expériences qui l’étaient tout autant. Je peux difficilement résumer tous leurs propos en quelques phrases. Mais effectivement, le seul sentiment de pouvoir raconter son histoire était très important pour les personnes à qui on n’avait jamais posé certaines de ces questions durant leur vie, même à l’extérieur de la prison.
Andrea Menard : Qui fait partie de votre groupe? Qui forme votre groupe d’étude – combien de professeurs y a-t-il? Supervisez-vous des étudiants au sein de votre groupe?
Justin Tetrault : Oui, cela dépend en quelque sorte de l’état d’avancement du projet, car nous y travaillons depuis 2016 – je réfléchis à haute voix. Le projet a démarré à l’origine avec la Dre Bucerius et le Dr Haggerty, chercheurs principaux, puis leurs étudiants de cycle supérieur, sous leur direction, ont pour ainsi dire poursuivi le travail. Nous avons commencé en 2015-2016, ou aux alentours. Presque dix ans plus tard, les gens comme moi sont devenus professeurs. Un autre de mes collègues, Luca Berardi, était étudiant de cycle supérieur et réalisait des entrevues. Il est maintenant professeur à l’Université McMaster. À l’origine, le groupe était formé de deux professeurs et de six, ou peut-être de 10 étudiants de cycle supérieur. Aujourd’hui, nous avons peut-être quatre professeurs ou plus et deux fois plus d’étudiants de cycle supérieur; la taille du groupe a donc presque doublé.
Le groupe se compose donc d’un mélange de professeurs et d’étudiants de cycle supérieur. S’ils sont prêts, ces étudiants se rendent dans les murs et réalisent les entrevues. J’étais étudiant lorsque j’ai commencé à faire des entrevues. Réaliser des entrevues en milieu carcéral représente tout un défi. Il faut – je ne sais pas trop comment formuler le tout, mais il vous faut le bon type de personne. Quelqu’un qui ne juge pas les gens quand il leur parle. Si une personne vous dit : « Je me bats contre une dépendance au crystal meth depuis trois ans », vous devez être en mesure de discuter avec cette personne sans la juger. Il faut aussi être capable de discuter avec des gens de la rue, de s’adapter et de rire au bon moment et de savoir quand il ne faut pas rire. Et, de toute façon, il est difficile de trouver des personnes pour réaliser des entrevues et bien le faire, c’est un travail très difficile, mais je crois que nous avons eu la chance de pouvoir compter sur un assez bon groupe qui n’était pas si mal au fur et à mesure que les travaux avançaient.
Andrea Menard : Alors, non seulement vous allez dans les prisons, mais vous éduquez et vous formez les étudiants qui font partie de votre groupe. J’aimerais donc revenir sur ce point, parce qu’il s’agit là davantage d’un lien humain. On peut donc dire que vous formez les étudiants afin qu’ils soient sensibles aux traumatismes et leur apprenez comment créer des liens avec d’autres êtres humains?
Justin Tetrault : Oui, et c’est super important. Pour ajouter à ce que vous venez de dire, je peux vous affirmer que presque tous les gens, soit de 80 à 90 % de toutes les personnes à qui nous avons parlé, avaient vécu des expériences traumatisantes. Les intervieweurs doivent donc posséder un autre type de compétences lors de ces entretiens, car vous savez que vous aurez à parler à des personnes qui ont vécu, franchement, les pires traumatismes que l’on puisse imaginer. Nous avons entendu les pires histoires possibles. Je ne vais pas m’étendre davantage sur cet aspect, mais vous êtes appelé à parler avec des gens qui ont vécu toutes les pires choses auxquelles vous pouvez penser. Donc, en tant qu’intervieweur, vous devez en être conscient en permanence et savoir comment orienter la discussion, tout en laissant la personne participante diriger la conversation. C’est un peu pourquoi nous avons gardé notre étude initiale bien ouverte.
Donc, nous entrions dans la salle avec les feuilles d’inscription, puis nous laissions les participants parler de ce qu’ils voulaient. Il y avait évidemment des points que nous voulions aborder, comme les programmes, le personnel, et peut-être quelques mots sur leur combat contre les drogues, sur la santé mentale ou physique, ce genre de choses. Nous avions donc les sujets dont nous voulions entendre parler – une palette très vaste, mais nous laissions nos participants diriger la conversation et l’orienter comme ils le voulaient. L’intervieweur devait parfois diriger, non pas diriger, mais orienter les propos si le participant allait vers des aspects plus sombres ou si l’on pouvait voir qu’il commençait à devenir perturbé. Il faut un intervieweur habile pour amener ces personnes vers autre chose : « Et puis, parlez-moi donc de la nourriture qu’on vous sert… », si vous sentiez monter en eux une certaine frustration.
[…] C’était véritablement une nouvelle expérience pour nous. Nous avons donc appris très rapidement à cheminer à travers ces échanges, à former les gens, à parler comme il se doit, etc. De plus, notre chercheuse principale avait travaillé dans des établissements de soins en santé mentale et possédait l’expérience nécessaire pour s’entretenir avec les personnes dans ce genre de situation. La Dre Bucerius arrivait très bien à nous expliquer comment mener
ces conversations.
Andrea Menard : Vous en avez parlé un peu en introduction, mais qu’est-ce qui vous a amené à choisir ce champ de recherche?
Justin Tetrault : Je me suis toujours intéressé d’une manière ou d’une autre aux questions raciales au Canada, de façon générale parce que, franchement, bien des Canadiens croient que le racisme ne constitue pas un problème dans ce pays, ou que nous ne sommes absolument pas comme les États-Unis quand il est question d’inégalités fondées sur la race, ce qui n’est pas du tout le cas. Donc cette question a toujours fait partie de mes champs d’intérêt, surtout avec ce qui s’est passé dans ma famille, et tout.
De plus, pour ce qui est des programmes destinés aux Autochtones – je pense qu’il serait important d’expliquer de quoi il s’agit. Les programmes autochtones sont, à la base, des ressources culturelles offertes dans les prisons. Il s’agit donc d’aspects propres aux Autochtones, comme le fait d’offrir aux détenus du matériel pour les cérémonies, des tambours, la possibilité de faire une purification par la fumée, et parfois du perlage; inviter des aînés à la prison ou en embaucher. La question des aînés est complexe, je ne vais pas trop m’étendre là-dessus. Mais comme un pasteur chrétien peut venir et s’entretenir avec les gens, un aîné autochtone peut venir et discuter avec les détenus et jouer un peu le rôle de thérapeute. Ils organisent également des cours – c’est un bien grand mot, car ces activités sont parfois organisées de manière très élastique –, où des personnes viennent enseigner en quoi consiste l’histoire coloniale, les pratiques de guérison propres aux cultures autochtones de la région, la spiritualité, et ce genre de choses.
J’ai donc écrit sur ces questions au cours des dernières années. Ce qui m’a attiré vers ces enjeux est le fait que nos participants, comme nous en parlerons peut-être plus tard, jugent ces aspects très précieux pour eux. Ce qui m’a aussi incité à écrire sur ces questions est la façon dont ces enjeux sont abordés dans le discours universitaire traditionnel et dans la culture populaire, où on les décrit de façon négative – je suppose que je devrais dire qu’il s’agit de questions controversées. Les programmes culturels offerts en prison sont controversés. D’un point de vue libéral, les personnes qui écrivent sur ces enjeux sont les plus progressistes et les plus à gauche lorsqu’ils critiquent ces programmes et ils considèrent qu’ils sont l’équivalent des pensionnats; vous amenez une bande d’Autochtones dans une salle de cours et vous leur apprenez à agir « comme de bons Indiens » et ce genre de choses. Et ces programmes sont simplement des versions édulcorées de la culture autochtone. Vous avez ensuite les perspectives plus à droite ou plus conservatrices, par exemple : « Ces personnes n’ont pas besoin de programmes culturels, parce qu’on ne devrait pas faire de favoritisme ethnique en prison. Et nous savons que les prisons servent à punir ».
Tout ce qui a été écrit à ce sujet sert essentiellement à dénigrer ces programmes, alors que nos constatations, lorsque nous nous rendons sur place et que nous parlons aux gens, disent plutôt que ces programmes sont d’une valeur inestimable. On nous a dit par exemple : « Je suis tellement reconnaissant pour la cérémonie du calumet qui aura lieu mercredi prochain », ou encore « Je suis si heureux d’avoir du foin d’odeur dans notre unité, pour m’aider lorsque surgissent des souvenirs traumatisants. » Ou même lorsqu’il est question des pensionnats – nous avons réalisé des entrevues avec des survivants des pensionnats. C’est ce qui m’a incité à écrire sur ce sujet, parce que j’étais en total désaccord avec à peu près tout ce qui avait été écrit à ce sujet, car ce n’est pas ce que révélaient nos conclusions. Il ne s’agit pas de dire que ces programmes sont la réponse à tous nos problèmes, mais j’ai cru qu’il était important d’écrire sur ce que nos participants ont à dire parce que, encore une fois, il s’agit de l’une des premières études du genre, dans ce pays à tout le moins et de cette envergure, et je pense que ces personnes ont fait des déclarations très percutantes à propos des programmes culturels et que ces déclarations n’étaient pas fondées sur des entretiens avec les gens et sur le récit de leurs expériences ni sur la façon dont ces personnes ont réellement vécu ces programmes.
De plus, si on se penche sur les rapports de la CVR (Commission de vérité et réconciliation) ou de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées – on constate que dans les deux, on demande de meilleurs programmes. Je me suis donc intéressé à ce que disaient ces rapports sur les prisons de façon générale, et sur ce que nous pourrions faire pour les personnes incarcérées ou qui ont été libérées. Ces facteurs ont donc eu une influence sur ma motivation à écrire sur cet enjeu.
Denise Webb : Je me demandais si vous pouvez nous en dire plus sur ce que vos travaux de recherche peuvent nous révéler sur les besoins et les intérêts des Autochtones qui sont en prison en ce qui a trait à la santé, et si vous avez trouvé quoi que ce soit relativement aux femmes et aux hommes autochtones, s’il y a aussi des différences entre les deux?
Justin Tetrault : Bien sûr. Il y a évidemment beaucoup à dire sur ce sujet. Je parlerai d’abord de la santé autochtone, puis nous pourrons aborder les enjeux plus larges liés à la santé et à la prison. Mais pour ce qui est de la santé autochtone – je pourrais commencer, je crois, par dire que la conception autochtone de la santé est beaucoup plus globale. Ce que je veux dire, c’est que d’un point de vue occidental, nous avons tendance à considérer la santé selon son aspect physique, c’est-à-dire qu’elle concerne le corps. Dans les dernières décennies, nous avons enfin commencé à parler de santé mentale, de santé affective. On commence à prendre ces choses plus au sérieux. Pour les Autochtones – sans vouloir généraliser, bien sûr, puisque les cultures autochtones sont différentes les unes des autres, mais de façon générale, pour les Autochtones – la santé est aussi spirituelle et relationnelle, ou, autrement dit, liée à nos relations, nos relations avec les autres ou avec nous-mêmes, avec notre terre ou notre communauté. Si les gens de notre auditoire connaissent la roue de médecine ou en ont entendu parler, ils savent qu’elle comporte quatre éléments liés à la santé, soit les aspects physique, mental, émotionnel et spirituel. Et si vous ne vous considérez pas comme une personne spirituelle ou religieuse, vous pourriez envisager la spiritualité comme étant votre responsabilité à l’égard des autres personnes ou de la terre ou votre relation avec celles-ci, ou avec votre demeure dans votre communauté, et aussi votre relation avec vous-même. Ce que je veux dire, c’est que nous avons besoin de commencer par cet aspect lorsqu’on pense à la santé autochtone et que ces programmes, du moins ceux que j’ai pu parcourir, tentent de s’orienter autour de ces notions autochtones de la guérison en tant que concept global qui intervient sur les relations, sur la réflexion sur soi-même, sur la responsabilisation et ce genre de choses.
Un autre aspect à garder en tête est le fait que les Autochtones, et surtout les Autochtones incarcérés, encore une fois, souffrent de taux plus élevés de traumatismes et de traumatismes intergénérationnels. Les traumatismes intergénérationnels sont simplement, si les gens ne sont pas certains de comprendre, le fait que chaque génération d’Autochtones a vécu d’une manière différente les politiques coloniales; on songe par exemple à la relocalisation forcée sur des réserves, à la Loi sur les Indiens, au système de laissez-passer, aux pensionnats, à la rafle des années soixante, aux politiques qui ont cours de nos jours – ces divers traumatismes ont été transmis d’une génération à l’autre. Les personnes incarcérées sont déjà marginalisées et au sein de cette population, les Autochtones sont souvent encore plus vulnérables et marginalisés, avec des taux de victimisation plus élevés – ce n’est pas uniquement moi qui le dis, mais nos données le reflètent aussi.
Ce que je veux dire, c’est que les conséquences des traumatismes intergénérationnels entraînent des problèmes de confiance et d’estime de soi, et une forme de paralysie, de perte d’autonomie. Plusieurs de ces programmes destinés aux Autochtones sont donc conçus pour renforcer l’autonomie des personnes, pour les aider à se sentir fiers d’eux-mêmes, de leur communauté et de leur culture. Mais ironiquement, il y a une forme de tension ici parce que ces programmes ont été conçus, ou on a tenté de les concevoir avec pour but de renforcer la responsabilisation des personnes qui sont en prison. Les prisons, bien sûr, sont des endroits conçus pour déshumaniser et déresponsabiliser les gens, ce qui entre en contradiction directe avec ces programmes. Ainsi, au fil de mes travaux, en me disant que ces programmes ont du bon, j’ai observé des contradictions et constaté que ces programmes sont bien loin d’être parfaits. Je ne veux simplement pas que notre auditoire pense qu’ils sont une réponse à tous les problèmes. Or, même en gardant cela en tête, on réalise qu’il y a toujours une tension provoquée par le processus décolonial à l’intérieur des murs qui tente de donner plus d’autonomie aux gens, et l’aspect colonial de la prison, qui veut les réduire au silence, les déresponsabiliser et les déshumaniser.
Donc, avec ces programmes, l’apprentissage forme une large part de la guérison et de la santé. Apprendre sur les relations, en particulier sur le colonialisme et sur ce que sont les traumatismes intergénérationnels, sur ce que signifie le fait d’être autochtone au Canada, apprendre sur les répercussions du colonialisme sur nos communautés et nos familles – tout cela est lié à l’apprentissage sur soi-même. Si vous voulez guérir comme individu, si vous êtes aux prises avec les drogues, des agressions ou des enjeux familiaux, il est vraiment utile de savoir et de comprendre comment j’en suis arrivé là à un moment de ma vie, et comment ma communauté ou ma culture en sont arrivées là, à ce moment difficile. Et ces programmes, s’ils sont offerts correctement, aident à fournir aux gens un contexte, tel que : « Votre communauté est en difficulté parce que nous pouvons relier tout cela à des aspects colonialistes survenus par
le passé. »
Dans le même ordre d’idées, et pour revenir à la marginalisation, les personnes qui ont pris part à nos entrevues ont rarement fait des études collégiales – vous savez, un grand nombre de personnes au sein de notre auditoire ont vraisemblablement fait des études supérieures quelconques – et elles n’ont peut-être jamais entendu parler des répercussions des politiques coloniales sur leurs communautés. Il se peut que ces personnes n’aient aussi jamais entendu le mot « colonialisme » auparavant, ce qui peut être surprenant pour certaines personnes, mais en discutant de cette question avec eux, nous avons pu constater que pour nombre d’Autochtones incarcérés, ces programmes sont une occasion d’apprendre sur leur histoire et leur culture, souvent pour la première fois. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces personnes n’ont jamais pu recevoir un enseignement culturel auparavant. Nos participants ont tendance à citer leur mode de vie et leur contexte particulier comme principale raison pour ne pas s’être impliqué dans leur culture avant d’être incarcéré. Les gens sont entourés, peut-être, de drogues ou de violence, de gangs, ou sont en situation d’itinérance, autant de problèmes typiquement liés à la grande pauvreté. Les rafles sont un autre aspect auquel il faut aussi penser, et donc les services d’aide à l’enfance. Un grand nombre de personnes que nous avons interviewées, 30 %, je crois, avaient été confiées aux services sociaux à l’enfance. On les a retirées de leur culture. Et quand elles sont allées en prison, ironiquement peut-être, encore une fois dans ces institutions étranges et profondément coloniales, ces personnes participent à des programmes et apprennent : « Oh!, voilà donc ce qui m’est arrivé. Je suis Autochtone, mais je ne sais pas qui sont mes parents, je ne sais rien de mes antécédents, mais je me suis assis avec cet aîné et nous avons discuté de ce que seraient peut-être mes origines », et ce genre de choses.
C’est donc quelque chose qu’il faut aussi garder en tête. Ces programmes enseignent les aspects coloniaux. Il ne s’agit pas simplement de dire : « Voici ce que cela signifie d’être autochtone. » C’est aussi : « Voici ce que le Canada vous a fait. Et voici ce que le Canada a fait à vos communautés ». Certaines personnes parmi l’auditoire de ce balado se demandent peut-être comment ces programmes sont élaborés. Et franchement, je ne le sais pas vraiment. Le gouvernement n’est pas très transparent sur la façon dont ces programmes sont adaptés pour les Autochtones. Mais pour être bien clair, les gens se sont battus pour ces programmes; le gouvernement canadien n’est pas arrivé un jour en disant : « Oh, il y a beaucoup d’Autochtones dans les prisons, alors nous allons vous fournir des trucs que vous pourriez aimer. » Depuis les années 1950, les Autochtones se battent pour ces programmes. C’est pourquoi je suis frustré lorsque les gens les traitent avec si peu de respect, comme s’il ne s’agissait pas d’un mouvement décolonial parce qu’à mon avis, les Autochtones se sont battus pendant un demi-siècle pour avoir le droit de faire des cérémonies de purification par la fumée dans les prisons. Ils ont lutté pour que des aînés puissent y venir, ont exercé des pressions sur les prisons pour que l’on renseigne les gens sur les répercussions du colonialisme sur les communautés de personnes incarcérées, surtout lorsqu’un grand nombre d’entre eux viennent de la même communauté, dans certains cas. Ces programmes sont donc le résultat de décennies de lutte. Ils ne sont pas le fait du seul gouvernement canadien qui, un jour, a décidé de les implanter. Encore une fois, cela ne veut pas dire que ces programmes sont parfaits, mais ils sont tout de même issus d’un historique de résistance et c’est ce qu’il est important de garder à l’esprit.
Je suppose qu’il y a d’autres choses. Ces programmes aident les gens à faire face aux traumatismes coloniaux dans une plus large mesure, à être plus autonomes. Ils les aident à se sentir fiers de leur culture et de leur héritage. Parce que souvent, chez les personnes incarcérées, on en vient à croire à des stéréotypes racistes à propos des Autochtones, comme le fait de ne rien connaître du parcours ayant mené à leur arrivée ici – ces personnes se contentent de dire : « Eh bien, tous les Autochtones boivent trop », ou « Ils ont tendance à commettre plus d’actes criminels », et ce genre de choses. Ou « ils ont plus agressifs » et grâce à ces programmes, les Autochtones apprennent et déclarent « maintenant, je comprends pourquoi mon père était peut-être violent avec moi, parce qu’il a été dans les pensionnats toute sa vie, ou bien il était dans un pensionnat, puis a été confié aux services sociaux. C’est maintenant moi qui suis ce même parcours. »
Alors ces personnes commencent ensuite à mieux comprendre qui elles sont, à mieux comprendre leur communauté, de même que leur famille. Et un grand nombre de ces personnes, en particulier les plus marginalisées – l’une de nos participantes a d’ailleurs dit quelque chose comme : « Je n’ai jamais rien appris de ma vie ». Cette personne, que nous appellerons Jamie, pour préserver son anonymat, est arrivée dans un foyer de groupe à l’âge de 14 ans. Elle a été victime de violence dans ce foyer. Elle s’est enfuie, est devenue sans logis, et lorsque nous lui avons demandé ce qu’elle pensait des programmes, voici ce qu’elle a répondu : « Je n’ai jamais rien appris de ma vie. Et je peux enfin apprendre un peu, quelqu’un peut m’apprendre des choses. Je veux aller mieux, je veux faire mieux. Je veux avoir des relations. » C’est donc quelque chose de très important pour de nombreuses personnes qui ont du mal à avoir confiance en elles et n’ont jamais eu d’aide.
D’autre part, ces programmes tentent d’encourager les participants à nouer des relations telles qu’un réseau de soutien. Alors ce n’est pas […] lorsque je parle de « programmes », les gens pensent probablement à une salle de cours ou à un enseignant s’adressant à des gens, un peu comme dans un pensionnat; c’est ce à quoi pensent certains critiques, je crois. Mais en réalité, ce n’est pas ainsi que ça fonctionne; du moins, ce n’est pas ce que nous avons constaté. On vise plutôt à créer un réseau de soutien entre les aînés et les détenus au lieu de mettre de l’avant une approche coercitive imposée par le haut. De nombreux participants à qui nous avons parlé n’avaient pas eu de réseaux de soutien au cours de leur vie, surtout les personnes qui avaient eu des problèmes d’itinérance et autres, et qui, en revenant en prison, ironiquement – car il y a une ironie dans tout cela – venir en prison et disposer de ces programmes qui tentent de créer un réseau de soutien, demander aux gens de se soutenir mutuellement, parce que la guérison autochtone ce n’est pas simplement à propos de l’individu. Vous devez aider votre prochain, cette personne doit vous aider, nous devons nous aider les uns les autres et créer des liens et des relations pour grandir, même dans une communauté informelle comme celle qui se trouve à l’intérieur de la prison.
Et je crois que la dernière chose à ajouter – car on a beaucoup à dire –, la dernière chose qu’il importe de mentionner est que ces programmes sont nécessaires aux accommodements religieux et spirituels de base en prison, même d’un point de vue juridique. Ce que je veux dire, c’est que si vous allez en prison demain, le gouvernement, en vertu de la Charte, est censé vous offrir des accommodements religieux. Et pour les Autochtones, la religion, la spiritualité et la culture sont un peu la même chose. Séparer la religion et la spiritualité de la culture est une idée occidentale ou coloniale. Pour les Autochtones, la culture est la spiritualité, de façon générale à tout le moins. Je dirais donc, et je ne suis pas le premier à le dire, qu’un accommodement spirituel et culturel pour les Autochtones dans ces prisons est un droit humain et autochtone. C’est donc sous l’angle des droits autochtones que je tente de mettre en perspective les programmes culturels offerts dans les prisons.
Et oui, si nous sommes sérieux en matière de sécurité publique – si vous êtes peut-être davantage une personne conservatrice et l’êtes aussi en matière de sécurité publique – donc, si vous voulez que les gens aillent mieux et puissent sortir de prison, qu’ils deviennent des citoyens soi-disant « productifs » et « respectueux des lois » – peu importe l’expression que vous souhaitez utiliser – il vous faut offrir à ces personnes le soutien nécessaire à leur guérison. Nous avons constaté que ce soutien est incroyablement précieux pour les gens qui y ont recours. La plus grande difficulté associée à ces programmes est le fait qu’il n’y en a pas assez. On nous a dit des choses du genre : « J’ai une purification par la fumée par semaine, si je remets la paperasse nécessaire. C’est merveilleux lorsque j’ai la possibilité de le faire, mais soyons réalistes : je dois remplir des formulaires pour pouvoir procéder. » Ce serait un peu comme si un chrétien devait remettre un formulaire pour faire une prière, pas vrai? Le plus gros problème n’est pas le contenu des programmes, mais leur nombre insuffisant : « Je ne vois pas l’aîné assez souvent »; « Je n’ai pas assez de temps pour m’asseoir dans mes cercles avec mon réseau de soutien et discuter de ces choses »; « La prison n’en fait pas assez pour faciliter la spiritualité et la guérison culturelle. »
Voilà donc les plus grandes difficultés. Je rappelle que ces programmes ne sont évidemment pas une solution à la surreprésentation. Ce n’est qu’une toute petite part, mais une part essentielle, d’un projet plus vaste visant à mettre un terme aux incarcérations de masse. Je crois que nous devons répondre aux besoins urgents des personnes qui luttent à l’intérieur des murs, et ces programmes, je le rappelle, ne résoudront pas le problème, mais les gens ont besoin d’aide maintenant et je crois qu’ils sont une façon évidente d’aider ces personnes à aller mieux. Et si nous nous soucions de la sécurité publique et que nous voulons que les gens aillent mieux mentalement et physiquement comme sur les plans spirituel et affectif à leur sortie de prison, ces programmes leur sont indispensables.
- Musique -
Andrea Menard : De manière générale, et sur la base de vos recherches, que peut-on dire des problèmes de santé en prison?
Justin Tetrault : J’ai donc exploré les enjeux autochtones et oui, je peux parler plus largement de ce que l’on sait sur la santé physique et mentale. Pour être bien clair, en guise de préambule, je n’ai pas publié d’articles sur la santé précisément, mais je peux parler de questions d’ordre plus général comme je l’ai fait lors des entrevues, et je peux parler de certaines de ces choses.
La première chose est le régime alimentaire. En prison, vous ne mangez pas bien. C’est le cas, à tout le moins, de la moyenne des gens. Dans les prisons que nous avons étudiées dans l’ensemble – il s’agit dans tous les cas de produits transformés, de surgelés préparés en usine; des aliments qui sont réchauffés à la vapeur, la plupart du temps. Tout dépend de l’établissement. Beaucoup de pain, parce que le pain donne de l’énergie et ne coûte pas cher. Je me souviens avoir réalisé des entrevues avec certains hommes qui m’ont dit : « Nous mangeons environ un demi-pain par jour, parce que ça ne coûte pas cher, et que ça contient beaucoup de calories. » La prison peut prétendre qu’elle offre aux détenus des avantages nutritionnels en respectant les seuils de ce qu’elle peut faire en vertu des lois. Des études relient maintenant les séjours prolongés en prison à un risque accru de cancer, ce qui est attribuable en partie à une consommation élevée d’aliments transformés. Alors […] cette situation est particulièrement désastreuse avec les longues sentences; si vous restez en prison pendant dix ans, lorsque vous sortez, votre santé risque fort d’avoir empiré. Les détenus courent aussi un risque plus élevé de contracter une maladie d’origine alimentaire, parce que parfois, les aliments ne sont plus bons ou sont mal préparés, et qu’ils sont servis à 100 personnes d’un seul coup. Donc, le régime alimentaire est une chose à laquelle il faut penser, en ce qui concerne la santé, évidemment.
Le stress est vraisemblablement un autre grand problème. Cela est sans doute évident, mais la prison est un environnement stressant. Ces enjeux sont liés à la santé mentale également, mais ont aussi des effets sur la santé physique de base. Lorsque vous allez en prison, vous vivez un choc systémique. Vous ressentez du stress parce que l’on vous retire de votre famille et que l’on vous isole des gens que vous aimez. Dans bien des cas, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Vous perdrez sans doute bien des heures de sommeil. Vous aurez probablement peur de perdre votre emploi. En fait, vous perdrez probablement votre emploi. Et si vous perdez votre emploi, surtout si vous avez des enfants, notamment – vous vous demanderez sans doute : « Comment vais-je arriver à faire vivre ma famille? Comment vais-je pouvoir mettre quelque chose sur la table? » Vous pouvez donc imaginer le stress que cela représenterait si vous alliez en prison demain. Et oui, il est évident que le stress n’est pas bon non plus pour votre santé physique.
Le manque d’activité physique est un autre problème. Cet aspect est assez simple. Grosso modo, vous êtes dans une cellule minuscule la majeure partie de la journée, puis vous êtes conduits dans une aire commune plus grande pour – tout dépend de l’établissement, ce peut être pour 8 heures ou pour 10 heures, ou dans certaines prisons ce peut n’être qu’une ou deux heures. Mais autrement, vous êtes coincé dans un petit espace la plupart du temps et, je le suppose, vous savez que les lieux ne sont pas vraiment propices au mouvement et à l’activité physique. Si vous êtes un détenu à haut risque dans un établissement à sécurité maximale, vous n’irez pas du tout à la salle d’entraînement. Vous n’aurez aucun accès à de l’activité physique, ni au terrain de basket-ball, si même il y en a un. Il est important ici, je suppose, d’insister sur le fait que chaque établissement de détention est différent. En effet, si vous avez un terrain de basket-ball ou un tapis roulant ou autre, les choses sont bien différentes. Certaines unités sont dotées de salles d’entraînement, d’autres non. Il est donc difficile de parler de manière générale, car chaque établissement est différent.
La violence est un autre enjeu auquel il faut penser. La violence est chose courante dans une prison. Bien sûr, elle est liée à la santé physique. Il y a la violence des gangs, bien sûr, et ce genre de choses, mais la forme la plus courante de violence est le pouvoir qu’exercent les détenus les uns sur les autres. Qu’est-ce que je veux dire par cela? Eh bien, vous avez 80 personnes vivant ensemble dans une unité, un petit espace. Et quand vous avez autant de gens, vous avez nécessairement des conflits et des désaccords. Comment allez-vous résoudre ces désaccords si vous ne pouvez le faire verbalement? Eh bien, si le conflit ne peut être résolu, vous allez sortir les poings. Vous devrez aussi définir les règles propres à la vie communautaire dans l’unité et si des personnes enfreignent les règles dans votre unité, si vous dénoncez quelqu’un ou quoi que ce soit d’autre, il en résultera de la violence. Il y a donc beaucoup de violence, utilisée pour régner sur les gens, pour les punir et pour vivre en communauté, aussi malheureux que cela puisse paraître. Et bien sûr, la violence est liée à la santé physique.
Il y a aussi des problèmes de santé mentale en prison. J’ai fait mention du stress, de l’anxiété, de la dépression, ce sont là des problèmes évidents. L’ennui, que j’ai mentionné au début de notre entretien, est un problème majeur. Je n’insisterai jamais assez sur ce point. Si vous ne pouvez pas garder les gens occupés, il se peut que ceux-ci portent leur attention sur ce qui ne va pas dans leur vie, sur le fait qu’ils s’ennuient de leurs amis ou de leur famille, qu’ils ratent les anniversaires, manquent les vacances… Les gens parlent de Noël comme l’un des jours où il est le plus difficile d’être en prison, pour des raisons sans doute évidentes. Et quand les gens n’ont rien à faire – c’est une autre raison justifiant l’importance des programmes – quand on n’a rien à faire, on peut penser à soi comme – sans rien pour s’occuper l’esprit, surtout si l’on est stressé ou déprimé, on peut simplement – ce n’est pas le cas pour tout le monde, bien sûr – mais les gens auront tendance à ne penser qu’à des choses déprimantes. Alors, ils deviendront plus stressés, peut-être plus violents, ou se tourneront vers les drogues. Les personnes que nous avons interviewées nous ont dit que l’ennui contribue aussi à augmenter le nombre de bagarres. Et je suppose que l’on peut s’imaginer, par exemple, que si quelqu’un nous agace, pour nous qui sommes à l’extérieur, si c’est votre partenaire ou votre ami ou autre, vous pouvez dire : « Bon d’accord, je vais aller prendre un café », ou « Je vais regarder un film » ou « Je dois aller travailler ». Mais quand on est détenu, on est coincé toute la journée avec la personne qui nous énerve, pas vrai? Vous êtes dans la même pièce que cette personne, dans le même espace ouvert ou dans la même cellule. Il n’y a nulle part où aller. Vous ne pouvez pas fuir, alors vous pouvez imaginer que si quelqu’un vous tape sur les nerfs, ce n’est pas comme ce le serait pour nous – « Bon, eh bien, je sortirai prendre un café », ou « Je vais aller travailler ». Vous pouvez donc imaginer sans peine la poudrière que peut devenir une prison, pas vrai?
Il faut également penser à la surpopulation, un problème moins évident. Si vous vivez dans une prison – je suppose que l’intimité est liée à tout cela – si vous êtes en prison, donc, vous n’avez pratiquement aucune intimité. Il y a toujours des gens autour de vous et pour la plupart des gens, il n’y a pas vraiment de temps dans la journée où vous pouvez décrocher et passer un peu de temps tout seul. L’un des hommes que nous avons interviewés et dont le père était décédé nous a dit, par exemple : « Mon père était la seule personne qu’il me restait pendant que j’étais ici. Je lui parlais au téléphone tous les jours. Puis il est mort, et je n’ai pas pu faire mon deuil parce que j’étais continuellement entouré de gens, du personnel, d’autres détenus. Et nous devons constamment jouer les durs. En tout temps, vous ne devez montrer aucune émotion. » Et ce type nous a dit : « Je voulais seulement avoir un peu de temps tout seul. Je voulais pleurer. » Alors dans les faits, étrangement, cet homme a fait une demande pour être mis à l’isolement, à l’isolement administratif, pour être seul dans une cellule. Et on a accédé à sa demande.
Et avec la surpopulation, je ne crois pas l’avoir mentionné auparavant, mais la plupart des prisons où nous sommes allés étaient surpeuplées. C’est un problème énorme, non seulement au Canada, mais partout dans le monde, surtout avec ces politiques répressives, qui vont à l’encontre de la science, que nous avons élaborées et par lesquelles nous pensons, pour des raisons inconnues, qu’enfermer tout le monde est une bonne idée, même si cela est inefficace et très coûteux. Nous sommes allés dans des prisons où trois personnes vivaient dans une même cellule, et il est difficile de l’expliquer sans visuels, mais cette cellule était à peu près de la taille d’une petite salle de bain. Vous avez deux lits superposés, la toilette est tout près du lit et du lavabo, et la troisième personne dort sur le plancher. C’est difficile à croire – c’est une chose à laquelle vous penseriez si vous étiez dans un « mauvais pays », peu importe l’expression que vous utiliserez – où trois personnes se retrouvent dans une toute petite pièce, mais on est bien au Canada. Vous pouvez imaginer l’effet que cela peut avoir sur votre santé mentale, sur votre intimité et tout le reste. Aller aux toilettes avec deux autres personnes à moins d’un pied de vous et tout ça.
Pour ce qui est de l’institutionnalisation liée à la santé mentale, les gens disent des choses comme : « Je suis allé en prison tout au long de ma vie et je me sens comme si j’étais interné. » En fait, ce que les gens veulent dire par cela est que la vie en prison est rigoureusement microgérée. Je veux dire, on peut bien l’imaginer, non? En prison, on vous dit quand vous réveiller. Quand manger. Quand vous devez vous coucher. Ils vous disent quand aller travailler. Si bien que les gens diront : « J’ai été interné, j’ai été dépendant toute ma vie – j’ai passé les 10 dernières années en prison, avec des gens qui me disaient quoi faire. » Vous pouvez imaginer l’effet que cela peut avoir sur eux lorsqu’ils sortent de prison, les effets sur leurs relations ou leurs amitiés ou, dans certains cas, les conséquences pour les hommes plus âgés, qui n’ont jamais utilisé une carte de crédit, par exemple, ou n’ont jamais utilisé Internet, et qui sont libérés. La prison leur dit comment tout faire. Et on s’attend à ce qu’ils apprennent comment prendre l’autobus, s’orienter dans la ville, utiliser Internet, faire des opérations bancaires. Et on s’attend à ce que les gens sortent de prison et trouvent un emploi, qu’ils se débrouillent avec tout ça, alors qu’ils ont été détenus pendant les 10 ou 15 dernières années.
Je crois qu’il existe aussi des différences entre les hommes et les femmes. Les femmes ont aussi des besoins plus importants en matière de santé. Il y a par exemple des unités mère-enfant. Je réfléchis à ce que je peux dire, mais certaines prisons où nous sommes allés, peut-être l’une d’elles, je dirais, comporte une unité mère-enfant. Les femmes ont donc la possibilité d’avoir leur enfant avec elle, dans la prison, dans une unité. Et quand je parle d’une unité, c’est en réalité une maison. L’unité est une maison, alors il n’y a pas de barreaux, et tout ça, comme on voit dans les films. Je ne crois pas qu’il y ait bien des différences entre les hommes et les femmes en matière de soins de santé, sauf pour ce qui est des besoins de l’appareil reproducteur et ce genre
de choses.
Pour ce qui est de la question des soins de santé, je suppose qu’on ne reçoit pas de très bons soins de santé en prison. C’est peut-être une évidence. Les listes d’attente pour voir un médecin sont interminables. En gros, à moins qu’il s’agisse d’une urgence, vous risquez d’attendre des mois et dans certains cas une année ou même plus avant de voir le médecin, et à ma connaissance, la prison accorde la priorité aux cas les plus urgents. Le médecin et le personnel infirmier voient des patients tous les jours à la prison, en fonction de la gravité de leur cas – et c’est un peu dérangeant, mais il faut bien le dire : selon nos participants, il arrive que les gens se mutilent littéralement pour voir un médecin plus rapidement. Ainsi, si vous avez une rage de dents, par exemple, et que la douleur vous rend fou, les gens de la prison vous diront : « Ce n’est qu’une rage de dents, ce n’est pas si grave, tu peux bien attendre quelques mois (parfois même un an) avant de voir quelqu’un. » Les gens arracheront la dent eux-mêmes, se blesseront, ou aggraveront leur blessure dans le but d’obtenir des soins de santé plus rapidement. Encore une fois, c’est un détail troublant, mais il vaut la peine de le mentionner.
Pour les soins dentaires, nous a-t-on dit, à moins qu’il s’agisse d’une urgence, le temps d’attente pour voir le dentiste de l’établissement peut être de plusieurs années. Les médicaments sont aussi une part importante de cet enjeu. Bien sûr, les prisons sont dotées de pharmacies qui vous donnent des médicaments chaque jour. Mais dans notre étude, nous avons entendu un nombre infini de rapports sur des problèmes de médicaments qui n’étaient jamais administrés, dont le dosage était insuffisant ou qui étaient en pénurie dans la prison.
Il convient aussi de mentionner le vieillissement de la population carcérale. En effet, les détenus sont de plus en plus vieux. Les prisons ne sont pas conçues pour accueillir des installations de soins et en raison de diverses décisions gouvernementales liées aux sentences plus longues, les prisons abritent des gens très âgés. La population carcérale vieillit. Vous avez des gens plus âgés qui ont, à l’évidence, des besoins de soins plus importants. C’est plus coûteux. Je veux dire, encore une fois, si vous abordez la question d’un point de vue […] plus conservateur ou – il est incroyablement coûteux de garder en prison de vieilles personnes qui, très franchement, ne sont probablement pas une menace pour la sécurité publique. Alors, vous savez, est-ce la meilleure façon de gérer cette situation?
Voilà donc un résumé rapide des aspects qui me viennent à l’esprit en ce qui a trait à la santé. Il faut cependant ajouter quelques mises en garde, simplement parce que tout le monde est un peu différent. Je parle de manière très générale, mais les restrictions en matière de sécurité sont importantes. Alors si vous êtes à risque plus élevé, vous bénéficiez de moins de programmes, et c’est le cas même pour les programmes autochtones, probablement. Si le personnel considère que vous êtes à risque élevé, vous pourriez être considéré comme étant à risque élevé par le personnel des soins de santé également. Vous pourriez ne pas être en mesure de voir certains membres du personnel soignant. L’ironie, ici, tient au fait qu’habituellement, les détenus en sécurité moyenne ou maximale sont ceux qui ont le plus souvent besoin de ces soins ou de ces services de santé. Et souvent, ils n’ont pas accès aux soins parce que la prison craint que ces détenus aient des comportements violents ou agressifs ou autre, alors que ce sont ces personnes qui, ironiquement, ont le plus besoin de soutien en santé mentale.
Les drogues illicites sont un autre sujet de réflexion. On pourrait créer un balado tout entier sur la seule question des drogues, ou sur la consommation de drogues illicites uniquement. Ces drogues sont largement disponibles dans les prisons. Cela est peut-être surprenant pour certains, mais des gens nous ont dit que les drogues sont plus faciles à obtenir à l’intérieur de la prison qu’en dehors. Les détenus en apportent, le personnel en apporte. C’est un commerce énorme, énorme. Et les gangs prospèrent grâce à la vente de drogues dans les prisons, et ils augmentent tous les prix, car ils savent que les détenus sont souvent désespérés. En prison, les gens s’endettent et cette situation engendre des conditions propices à la violence. Il est également plus difficile et plus risqué de transporter des drogues, et leur circulation à l’intérieur des murs coûte plus cher, ce qui fait augmenter les prix d’autant. Il y a également de plus en plus de preuves que les personnes n’ayant jamais consommé de drogues courent plus de risque de commencer à le faire en prison, pour les raisons que j’ai déjà évoquées : stress, solitude, dépression, ennui. Mais aussi pour aider à dormir. Certains somnifères, selon les établissements, sont très populaires. Il arrive que ces produits soient prescrits à la prison. Mais si vous ne pouvez pas en obtenir sous ordonnance, vous pourriez trouver d’autres moyens de vous en procurer. Pour notre étude, nous sommes entrés en 2016, alors que les opioïdes dominaient le marché et que le fentanyl était devenu la drogue de choix parce qu’elle est facile à produire et peu coûteuse. Cette drogue est extrêmement puissante. Je crois qu’elle était utilisée comme tranquillisant pour les chevaux et ce genre de choses. C’était donc la drogue à l’époque, et je crois que c’est toujours le cas aujourd’hui. Il y avait des surdoses et tout ça.
Il y a encore quelques dernières choses à mentionner concernant la santé : il y a dans les prisons des programmes qui, vous savez, aident les gens avec des problèmes de santé mentale, en supposant que vous n’êtes pas en sécurité maximale. Habituellement, les détenus en sécurité minimale profitent d’un meilleur accès aux programmes. Encore une fois, il y a une certaine ironie dans le fait que parfois, des personnes qui n’ont pas autant besoin de soins que les détenus en sécurité maximale, soit les détenus en sécurité moyenne, obtiennent tout l’accès. Bref, ces programmes sont très rares et il y a de longues listes d’attente pour y prendre part. Il y a aussi des psychologues en prison, mais en prison, vous ne pourrez pas voir le psychologue toutes les semaines ni rien de ce genre. Vous aurez de la chance si vous y arrivez tous les deux ou trois mois ou quelques fois par année, à moins de circonstances particulières.
La dernière chose à mentionner en ce qui a trait à la santé – et il s’agit là d’un point important – car j’ai parlé de ces questions de manière assez générale. Mais nous avons fait une importante constatation, que nous appellerons la « prison comme refuge ». Il s’agit de l’une des conclusions les plus tragiques découlant des travaux que nous avons réalisés dans les prisons, et elle concerne aussi les enjeux autochtones. L’une des constatations les plus attristantes est que plusieurs […] – je parle ici des personnes les plus marginalisées de notre échantillon, qui vivent en situation d’itinérance, vivent de la violence extrême quand elles sont à l’extérieur et ces personnes sont souvent autochtones – un sous-groupe de nos participants ont affirmé que la prison était un refuge comparativement à leur vie à l’extérieur ou dans la rue. Alors parfois, pour ces personnes, la prison est un endroit où elles peuvent dormir en relative sécurité pour la première fois depuis longtemps, car elles nous ont dit que les refuges d’urgence ne sont pas nécessairement sécuritaires. Un article vient aussi de paraître dans l’Edmonton Journal à ce sujet, sur les femmes particulièrement. Les gens utilisent aussi la prison pour échapper au froid. Dans les Prairies, la température peut atteindre -40 oC chaque année et lorsque cela se produit, franchement, des gens meurent dans la rue.
Les prisons sont aussi un lieu où les gens peuvent échapper à un partenaire violent. Donc d’autres personnes, surtout des femmes, peuvent échapper à des partenaires violents en allant en prison, aussi étrange que cela puisse paraître. Pour d’autres encore, la prison permet d’obtenir des repas de façon régulière. Exactement : de la nourriture et un abri, et la possibilité de cesser de consommer des drogues souvent mortelles offertes dans la rue. Ces personnes utilisent essentiellement la prison comme fournisseur de services sociaux et cette constatation est troublante. Encore une fois, on ne parle pas ici de la moyenne des détenus, bien sûr. Par exemple, si l’un d’entre nous entrait en prison demain, il est évident que notre expérience serait bien différente. Mais encore une fois, on parle ici des plus marginalisés.
Autre chose : certaines personnes estimaient que les soins médicaux et dentaires en prison étaient en réalité plus accessibles pour eux que s’ils vivaient à l’extérieur. Et cela après que j’aie décrit les conditions difficiles de la vie en prison. Beaucoup de gens ont dit ne pas avoir à se soucier de leur prochain repas, de l’endroit où ils pourront dormir la nuit venue, s’ils sont en situation d’itinérance ou autrement. Pour être clair, ce n’est ni moi ni notre projet qui affirmons que les prisons sont un bon endroit où se trouver, bien sûr, mais cela permet plutôt de montrer l’envergure de l’échec de nos institutions et de notre société : la police, les services à l’enfance, les tribunaux, les refuges, les services de counseling médical – et le gouvernement, bien sûr – ont abandonné ces personnes de manière spectaculaire.
Voilà donc un résumé des grands points liés à la santé. J’ai probablement oublié quelques éléments, mais il est difficile de parler de toutes ces choses de manière très générale. Il s’agit en quelque sorte des principaux points.
Andrea Menard : Merci, Justin. À la suite de vos travaux de recherche, quels changements jugez-vous nécessaires pour répondre aux besoins et aux intérêts des Autochtones qui sont en prison?
Justin Tetrault : C’est une bonne question. En résumé, nous avons besoin de plus de transparence sur la façon dont les programmes sont adaptés à la clientèle autochtone avant d’être offerts : qui y travaille, quelles communautés y participent, est-ce que cette adaptation est adéquate? Il y a une grande diversité parmi les Autochtones, n’est-ce pas? Un Inuit n’a pas nécessairement les mêmes besoins culturels qu’un Métis, même s’il peut y avoir des chevauchements dans leurs besoins et des similitudes dans leurs expériences des politiques coloniales dans une certaine mesure. Mais ces programmes sont habituellement panautochtones, ce qui signifie qu’ils s’adressent aux populations autochtones dans une large mesure, ce qui est à la fois bon et mauvais. C’est une bonne chose dans le sens où « d’accord, nous pouvons nous asseoir tous ensemble et nous pouvons en apprendre un peu plus sur les effets des politiques canadiennes sur nos familles et sur nous-mêmes », mais les rituels de purification par la fumée peuvent n’avoir aucune pertinence pour cette culture, ou une pratique particulière n’avoir aucun rapport avec cette autre culture. En fait, idéalement, il faudrait des programmes sur mesure, aussi adaptés que possible aux personnes incarcérées, ce qui est difficile à faire. Mais il vaut la peine d’y réfléchir, alors que nous nous apprêtons à confier le contrôle de ces programmes aux communautés. Voilà pourquoi je demande plus de transparence, parce que nous ignorons l’envergure du contrôle qu’exerceront les communautés concernées sur ces initiatives. Nous savons qu’elles sont utiles, qu’elles sont importantes. Nous savons que nous devons continuer, je crois, à investir dans ces programmes dans une certaine mesure, mais nous devons faire preuve de transparence quant aux personnes qui participent à la démarche d’adaptation et nous devons accorder plus de contrôle aux communautés sur ces démarches.
Dans le même ordre d’idées, je n’ai pas encore abordé la question des pavillons de ressourcement, mais ces pavillons sont encore des prisons, bien qu’ils soient organisés pour convenir aux Autochtones – aux aspects des cultures autochtones. Ils ont tendance à être axés sur la réhabilitation, et tous les programmes que j’ai mentionnés sont intégrés à ces établissements. Je crois qu’il en existe dix – je n’ai peut-être pas le nombre exact, mais je crois qu’il y a en tout dix pavillons de ressourcement au Canada. Je crois que six d’entre eux sont exploités par le gouvernement et quatre sont pris en charge par des communautés ou des nations. C’est peut-être l’inverse, mais les chiffres n’ont pas vraiment d’importance, je crois, pour ce que j’essaie de relater. Il y a donc plus ou moins quatre prisons prises en charge par des communautés autochtones; c’est le cas de Stan Daniels, ici à Edmonton, de la prison pour femmes Buffalo Sage, administrée par Native Counseling Services of Alberta, je crois. Il s’agit donc d’établissements pris en charge par les communautés, et il ne s’agit pas de prisons traditionnelles. Il n’y a pas de barreaux aux fenêtres et les bâtiments font penser à un centre communautaire. Il y a des œuvres d’art sur les murs. On y encourage les gens à faire du perlage tous les jours, et des aînés s’y présentent. On tente de mettre sur pied une communauté qui facilite le retour de ces personnes dans la société […]. Idéalement, si nous considérons les prisons de manière fondamentale, nous devrions essayer de ramener les gens dans les communautés, dans de meilleures dispositions. Comment pouvons-nous y arriver lorsque les prisons sont de terribles établissements surpeuplés avec des barreaux aux fenêtres, où il n’y a rien à faire et il n’y a pas de programmes, pas de ressources? Les gens cherchent des choses à faire. Il y a des bagarres, de la violence, de la drogue. Comment pouvons-nous, concrètement, nous attendre à ce que les gens aillent mieux lorsqu’ils quittent ces endroits, réintègrent la communauté et deviennent de soi-disant citoyens « respectueux de la loi », ou toute autre expression que vous souhaitez utiliser? Les pavillons de ressourcement sont une tentative de créer un environnement communautaire qui favorisera l’autonomisation des personnes. Le modèle colonial occidental des prisons est, encore une fois, synonyme de déresponsabilisation, de déshumanisation et de justice vengeresse. Le modèle de prison autochtone, encore une fois, demeure une prison, alors il pose encore des enjeux, mais les pavillons de ressourcement sont un modèle adapté aux réalités autochtones, qui vise davantage à responsabiliser, à créer une communauté, à tisser des liens en utilisant ces modèles de guérison autochtones.
À mon avis, c’est là qu’il nous faudrait investir. Nous devons investir dans des approches plus globales de la guérison, comprendre les comportements et le non-respect des règles et voir comment les gens en arrivent à ce point dans leur vie. Cette idée n’est pas facile à vendre au public, car il faut lui dire, essentiellement, que « nous devons investir dans des personnes qui pourraient avoir causé des préjudices à d’autres personnes ». Ce n’est pas chose facile. Les personnes en prison sont le dernier groupe de gens dont les autres se soucient, n’est-ce pas? Si le gouvernement doit effectuer des compressions quelque part, on se dira : « Eh bien, les gens en prison, ça n’intéresse personne. Alors c’est là qu’on va couper. » Mais une telle décision a des conséquences. La sécurité publique est touchée, les familles également, de même que les communautés autochtones. Bref, je crois que s’il devait y avoir des changements immédiats, on investirait dans des initiatives adaptées aux réalités autochtones, dans les pavillons de ressourcement visés à l’article 81 (c’est ainsi qu’on les désigne). Il s’agit des pavillons de ressourcement administrés par les communautés. Il existe aussi des pavillons de ressourcement des gouvernements et ceux-ci sont de loin préférables aux prisons occidentales traditionnelles, mais ils sont quand même administrés par SSC[1], donc par le gouvernement. Et j’appelle à la transition de ces pavillons de ressourcement afin qu’ils soient pris en charge par les Autochtones.
Je suppose que le thème plus large est celui de l’autodétermination des peuples autochtones. Si on parle de la CVR ou de l’Enquête nationale, ces documents nous demandent ou encouragent le contrôle des Autochtones sur leurs vies et sur leurs communautés. Il y a des luttes autochtones en vue de reprendre le contrôle des services de protection de l’enfance, et diverses nations ont commencé à le faire, ce qui est très enthousiasmant pour bon nombre d’entre nous. J’aimerais aussi voir des choses semblables en matière de justice et de guérison : reprendre le contrôle sur les tribunaux, sur les sentences et sur les démarches de réinsertion. Alors les Autochtones travailleraient avec des Autochtones à réintégrer des Autochtones dans leurs communautés. Si on parle de peuples autochtones uniquement, mais je suppose que je devrais aussi dire que les Autochtones ne pensent pas, du moins selon mon expérience, ils ne pensent pas qu’il s’agit d’une question qui ne concernent qu’eux seuls – nous sommes tous des êtres humains, aussi ringard que puisse sembler cette affirmation. Nous sommes tous des êtres humains; ce genre de choses peut aider tout le monde. Les Non-Autochtones pourraient aussi participer à ces programmes. Ils pourraient eux aussi aller dans des pavillons de ressourcement. Ils pourraient trouver de la valeur dans les pratiques culturelles, tant qu’ils ne se les approprient pas ou qu’ils ne font pas preuve de prétention et ce genre de choses. Ces approches sont valables pour tout le monde. Et je crois que ce modèle ne convient pas uniquement aux Autochtones, mais qu’il s’agit d’un modèle de réinsertion et de guérison plus large, auquel nous devrions réfléchir un peu plus et dans lequel nous devrions aussi investir davantage.
Denise Webb : Merci. Pourriez-vous nous donner des exemples de façons dont vos travaux ont pu influencer la modification des politiques dans le système carcéral?
Justin Tetrault : Pour commencer, je dirais que tout cela est relativement nouveau. Nous travaillons depuis 2016, et c’est depuis lors que nous recueillons des données. Il y a eu ensuite la pandémie, puis nous avons pris une petite pause et nous avons commencé à publier sur la base de ces quatre premières années de données. Nous avons donc publié un article sur les données concernant les victimes, et cet article a sans doute été ce qui a le plus intéressé les décideurs. Le gouvernement parle le langage des politiques et des données. Il s’est donc intéressé à nos statistiques sur la victimisation et sur l’expérience des personnes en matière de criminalité violente et de victimisation sexuelle. Ces données ont donc été utilisées pour mettre sur pied un programme de services aux victimes dans les prisons. Je crois que le service de police d’Edmonton, l’Edmonton Police Services (EPS) a utilisé nos données sur la victimisation pour créer une politique sensible aux traumatismes ou quelque chose du genre, je ne suis pas certain des détails à ce sujet. Mais c’est sans doute parce que c’est l’article où on retrouvait le plus de texte de type gouvernemental qu’on l’a utilisé pour l’élaboration de politiques.
En ce qui concerne le travail que je réalise, le gouvernement s’intéresse beaucoup moins à la criminologie narrative. Mes publications, par exemple, contiennent des données sur la victimisation, mais l’expérience des programmes par les participants est davantage relatée dans un texte courant. Il s’agit donc de personnes qui racontent leur expérience de tel ou tel programme et la façon dont il les a aidés. Le gouvernement ne s’intéresse pas tellement à ces récits, parce qu’il ne s’agit pas de chiffres et que ce ne sont pas des éléments qui peuvent se traduire en chiffres. Avec notre nouvelle étude, nous tentons de faire en sorte que notre nouvelle recherche sur la réinsertion adopte un langage « gouvernemental » qui les intéressera, que le gouvernement écoutera. Parce que je peux […] rédiger mon article sur l’appréciation des programmes culturels par les participants, mais ce n’est pas suffisant pour que les décideurs écoutent et se disent : « Oh, nous devrions investir dans telle ou telle chose ». Ils aimeraient plutôt savoir : « Alors, ont-ils cessé de commettre des actes criminels une fois en liberté? Quelles données pouvez-vous me donner sur le lien entre les visites d’un aîné et la récidive? », et ce genre de choses.
Nous apprenons donc, au fur et à mesure que nous avançons dans la réalisation de ce projet, comment réaliser des travaux de recherche qui auront un impact. Selon notre étude de 2016 à 2020, les statistiques sur la victimisation sont celles qui ont eu le plus de répercussions et c’est une bonne nouvelle, mais si je devais revenir en arrière et revoir le concept de cette étude, j’inclurais probablement plus de questions de type « sondage » sur – je ne suis pas certain, je réfléchis à voix haute ici –, sur des aspects qui déboucheraient sur de meilleures décisions politiques. Encore une fois, nous avons le récit de personnes qui relatent leur expérience et encore une fois, le gouvernement a peu d’intérêt pour ces récits.
J’ignore si je réponds bien à votre question, mais je peux peut-être vous en dire plus en parlant des effets de notre nouvelle étude, avec laquelle nous essayons d’être plus sensibles à ce que les gens écouteront et qui pourra faire une différence.
Denise Webb : Oui, je pense qu’il s’agit justement de notre prochaine question. Pouvez-vous nous en dire plus sur l’axe autour duquel repose ce projet de recherche, cette nouvelle étude sur la réinsertion, et sur les aspects inconnus qui seront examinés?
Justin Tetrault : Oui, bien sûr. En fait, quand avons-nous commencé? Nous menons présentement une étude qui durera sept ans et que nous avons amorcée il y a maintenant un peu plus d’un an. Cette étude porte, comme je l’ai déjà dit, sur la réinsertion dans la communauté. Donc notre première étude, celle de 2016 à 2020, portait sur l’expérience vécue par la clientèle à l’intérieur des prisons. Il s’agissait d’une étude exploratoire; nous n’avons pas retenu un seul enjeu particulier sur lequel nous concentrer et c’était en quelque sorte une étude « ouverte ». Donc avec cette étude, nous nous interrogions simplement sur ce qui se passait dans les prisons. Nous ne le savions pas vraiment. « Comment sont les gangs? Que se passe-t-il avec les drogues? Et la santé mentale? En quoi consistent les programmes offerts? » Il s’agissait d’une étude ouverte, de nature exploratoire.
La nouvelle étude que nous venons d’amorcer se penche sur la réinsertion. Donc, que vivent les personnes qui sortent de prison? Bref, nous interrogeons les personnes détenues qui sont sur le point d’être libérées, puis nous procédons à une autre entrevue avec ces personnes une fois qu’elles sont libérées afin qu’elles nous parlent de leur réinsertion. Nous réalisons une étude longitudinale, ce qui veut dire que nous réalisons jusqu’à cinq entrevues avec la même personne au cours de l’année suivant sa libération. Les questions que nous posons peuvent porter, par exemple, sur ce qui suit : « Cette personne a-t-elle été incarcérée de nouveau? Comment cette personne définit-elle une réinsertion réussie? Quelle aide reçoit-elle? A-t-elle des pièces d’identité? Quel moyen de transport utilise-t-elle? » Et nous organisons davantage notre contenu, comme je le disais, avec un langage plus « politique ».
Donc, la forme de cette étude se rapproche davantage de celle d’une enquête – nous y avons inclus des entrevues et des éléments ouverts, mais elle est plus structurée selon un langage associé aux politiques, d’accord? Parce que là, nous pourrions, une fois que nous avons les conclusions de l’étude, déclarer, par exemple, que « Donc, 70 % des personnes de notre échantillon ne possédaient pas de permis de conduire à leur libération. Nous devrions donc lancer un programme qui permettrait aux personnes en réinsertion d’avoir accès à un permis de conduire, car on aiderait ainsi 70 % des détenus. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous pouvons facilement adopter un langage que les décideurs comprendront et auquel ils pourront rattacher des données chiffrées. Jusqu’à maintenant, nous avons réalisé des entrevues avec environ 500 personnes, alors nous sommes à mi-chemin de l’étude, ou du moins à la moitié des entrevues initiales, car si vous vous rappelez bien, nous réalisons des entrevues avec ces personnes durant un an après leur libération. Nous réalisons donc un grand nombre d’entrevues, et nous visons un échantillon représentatif de 1 000 personnes, ce qui représente environ 30 % la population carcérale de l’Alberta dans les établissements provinciaux.
En d’autres mots, ces conclusions devraient permettre d’apporter des changements fondés sur des éléments probants et d’offrir des mesures de soutien, et c’est ce qui nous intéresse avec cette étude. Cette recherche aura-t-elle des répercussions? Nous avons bon espoir que ce sera le cas, car nous avons eu, encore une fois, une participation enthousiaste qui a de quoi nous réjouir. C’est que nous étions inquiets – même si nous avions connu un vif succès lors de la première étude –, en fait nous sommes toujours inquiets lorsque vient le temps de nous rendre dans les prisons. Nous nous demandons toujours si des gens vont s’inscrire, s’ils voudront nous parler… et nous avons pu constater que notre étude a suscité un bon enthousiasme.
Voilà donc ce qui forme l’essentiel de cette nouvelle étude. Ce n’est pas simplement une affaire de permis de conduire, de pièces d’identité ou ce genre de choses (les transports), mais de toutes sortes de choses, tel que la manière dont on définit une réinsertion réussie. Parce que le gouvernement définit une réinsertion réussie par le fait qu’une personne a ou non commis un autre acte criminel. Une réinsertion réussie veut donc dire que la personne a été libérée, et – peu importe qu’elle soit en situation d’itinérance ou qu’elle ait des problèmes de toxicomanie – si elle n’a commis aucun crime, on considère que sa réinsertion est réussie. Or, il est évident que la notion de réussite dépend, dans ce contexte, de la personne à qui on parle. Nous avons donc demandé à nos participants de nous dire ce qu’ils croyaient être une transition réussie. Et ceux-ci nous ont répondu qu’ils voulaient voir leurs enfants, vaincre leur dépendance aux opioïdes, ou encore trouver un emploi et avoir un domicile fixe, ce genre de choses. Il s’agit donc de savoir comment les gens définissent la réussite et comment ils vivent – ou pas – leur réussite, ainsi que les obstacles à cette réussite.
Voilà ce qui forme l’essentiel de cette étude. Je me concentre évidemment sur les enjeux autochtones, mais pas seulement, mais c’est quand même mon domaine, n’est-ce pas? Alors, les personnes qui retournent dans les réserves, qui bénéficient d’un soutien culturel à leur sortie, vous savez, c’est ce que nous appelons un cadre de réhabilitation continu (through care). Ce que nous constatons, c’est qu’un grand nombre de personnes, et pas uniquement des Autochtones, mais que beaucoup de gens profiteront d’un soutien en santé mentale lorsqu’ils sont en prison ou profiteront d’un soutien spirituel culturel lorsqu’ils sont détenus. Ils pourront prendre part à des rituels de purification par la fumée et voir un aîné. Puis on les relâche dans le centre-ville d’Edmonton et ils n’ont plus rien de tout cela. Toute cette aide a disparu. « Vers qui dois-je me tourner pour voir un aîné? », ou encore « Qui dois-je aller voir pour obtenir de l’aide avec les drogues […] J’avais un peu d’aide en prison, très peu. Puis j’ai été libéré et je n’ai plus rien. » C’est ce qui nous intéresse. C’est ce que nous appelons un cadre de réhabilitation continu. Existe-t-il des soins qui sont offerts en prison et qui peuvent se poursuivre jusque dans la communauté?
Nous attendons des nouvelles d’une subvention pour l’Initiative sur les services correctionnels communautaires destinés aux Autochtones; c’est ainsi que l’on désigne la subvention de Sécurité publique Canada. Mais nous espérons, si nous obtenons le financement, mettre sur pied un centre de réinsertion dirigé par les Autochtones au centre-ville d’Edmonton. Ce centre s’appelle pour le moment – il pourrait ne pas conserver ce nom toutefois – l’Edmonton Healing and Integration Center (EHIC), soit le Centre de guérison et d’intégration d’Edmonton. Nous avons quelques partenaires communautaires, quelques aînés qui travaillent avec nous et qui assureraient un soutien culturel à l’interne pour les personnes réintégrant la société. Et avec ce financement, essentiellement, nous pourrions fournir – nous ne pourrons pas offrir de refuge ou de logement, et tout cela pour les gens –, mais si vous sortez de prison, vous venez à notre centre et nous pourrons vous diriger vers des ressources. Ces choses existent dans la communauté, de diverses façons, mais nous songeons à créer un carrefour, dirigé par des Autochtones, et à mettre nos travaux de recherche à contribution pour établir ce centre. Cela pourrait aider les gens à élaborer un plan de réinsertion. Nous aurions ensuite un lien culturel à l’interne, grâce à nos aînés qui travailleront avec les gens et aideront à leur réinsertion. Quant à nos partenaires culturels, ils nous ont dit : « Nous travaillons continuellement avec des personnes sans logis et auprès de gens de la rue; nous savons que lorsqu’ils quittent la prison, ils sont aux prises avec de multiples difficultés. Ils sont sans ressources et nous voulons créer quelque chose pour les aider, mais nous ne sommes que des travailleurs communautaires. Nous ne possédons pas l’expertise, les connaissances ou les données pour mettre sur pied quelque chose de ce genre. » C’est donc là qu’en tant que chercheurs – et c’est pour cette raison que la recherche est si importante –, nous pouvons intervenir et travailler avec eux et dire : « D’accord, nous avons interviewé 1 000 personnes (je donne ce chiffre à titre d’exemple ici) et 800 d’entre elles nous ont dit quels étaient leurs besoins. », ou « 100 personnes nous ont dit que c’est ceci dont elles avaient besoin », ou « Les gens vivant sur les réserves nous ont dit que c’est cela dont ils avaient besoin », ou encore « Les jeunes de ce secteur de la ville… » Vous voyez ce que je veux dire? Nous pouvons analyser et définir les besoins de chaque groupe individuel avec cette nouvelle étude, et c’est ce que nous espérons faire.
Permettez-moi d’ajouter une autre chose concernant le soutien aux Autochtones et la question précédente : une bonne part du soutien offert est temporaire. Ce que je veux dire, c’est qu’il y a beaucoup d’initiatives en matière de logement, d’initiatives de réinsertion dirigées par des Autochtones, de projets correctionnels communautaires, de stratégies de justice autochtone, mais il s’agira toujours de mesures temporaires. On vous dira : « Voici du financement pour cinq ans, et après cinq ans, vous devrez déposer une nouvelle demande et vous aurez peut-être du financement à nouveau. Peut-être devrez-vous mettre à pied tout votre personnel et que vous ne pourrez jamais répéter ce programme. » Je me suis rendu à la rencontre régionale de la Stratégie en matière de justice autochtone, et l’un des grands problèmes qui y a été soulevé est que vous avez ces programmes vraiment formidables avec des personnes dévouées et passionnées qui font du bon travail… et qui cessent au bout de deux ans. Le financement est épuisé et vous devez présenter une nouvelle demande, vous échouez, ou vous n’avez pas les ressources pour préparer cette demande, ou encore votre programme n’est pas en mesure de se poursuivre. À ce moment-là, tout ce que fait le gouvernement est de mettre sur pied des projets temporaires, n’est-ce pas? Il s’agit de programmes à court terme, pendant que la prison, bien sûr, reçoit un financement récurrent et imposant, bien sûr; des milliards de dollars. J’aimerais donc que l’on investisse dans les personnes. Je crois que c’est vraiment là qu’il
faut aller.
Andrea Menard : D’accord. Passons maintenant à la dernière question. Comment ces travaux peuvent-ils être liés à la justice réparatrice et à d’autres solutions de rechange et initiatives communautaires en matière de justice?
Justin Tetrault : Oui, je crois que j’aimerais faire le lien avec le point précédent. On accomplit beaucoup de bon travail. J’essaie toujours de rester optimiste quand je m’adresse aux étudiants, que j’enseigne à ce sujet ou peu importe, ou que je fais des entrevues comme celle-ci. On a souvent l’impression, quand on travaille dans ce domaine, qu’il n’arrive jamais rien de bon, qu’on ne réalise aucun progrès, que tout empire et devient encore plus sombre. Et, oui, je comprends pourquoi les gens en arrivent à ces conclusions. Mais en faisant ce travail, je vois aussi tout ce que les gens accomplissent, tous les efforts déployés au sein et à l’extérieur du système pour aider les personnes qui sont dans le système. C’est ce qui m’est arrivé lors de la réunion de la Stratégie en matière de justice autochtone; des choses dont je n’avais jamais entendu parler. Je parle de façon générale, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des initiatives autochtones en matière de logement, comme NiGiNan Housing Ventures. On m’a remis la carte d’une initiative en matière de logement dirigée par des Autochtones, à Edmonton. Il y a donc des choses qui se passent. Je sais que la juge Anna Loparco et Sandra Christensen-Moore font un très bon travail en matière de justice réparatrice.
La justice réparatrice n’est pas tout à fait parmi les aspects que j’ai étudiés, mais elle en est proche, évidemment, quand il est question de relations axées sur la guérison et ce genre de choses. Je commence à peine mes travaux de recherche sur la justice réparatrice. Des professionnels du milieu et des gens œuvrant dans le système y contribuent également. La justice réparatrice est donc, selon moi, une autre initiative positive. Encore une fois, ce n’est pas la solution à tous nos problèmes, mais il y a des gens qui créent des choses. Et je crois qu’il nous arrive d’être impatients parfois, parce qu’on a l’impression que rien ne change, mais les choses bougent. La Stratégie nationale en matière de justice réparatrice est un autre élément dont j’ai fait mention et au sein duquel j’ai tenté de m’engager. Et lorsque notre centre de réinsertion sera en activité, il s’agira d’un autre élément que nous espérons lier à d’autres groupes. Beaucoup de gens nous ont fait part de leur intérêt – nous travaillons avec United Way, Bent Arrow et avec les Native Counseling Services. La nation métisse de l’Alberta a manifesté un vif intérêt pour notre projet de réinsertion, et les choses avancent.
Et je crois que pour notre auditoire, il existe toujours des moyens de s’impliquer, même si on n’est pas un expert. Il y a par exemple dans la province des comités jeunesse de justice réparatrice. Ces comités sont essentiellement utilisés pour détourner les jeunes des prisons et leur éviter un casier judiciaire. J’ai donc travaillé avec une communauté de Camrose. Il s’agit d’organismes bénévoles, et vous n’avez pas besoin d’être un expert en justice pénale. En gros, la police inculpe un enfant et l’agent de police – j’ignore si le tout est laissé ou non à sa discrétion, je ne connais pas tous les détails, il peut s’agir d’un policier ou des tribunaux –, bref, cette personne dit : « Cet enfant est inculpé; au lieu de l’envoyer en prison ou d’inscrire des accusations dans son dossier, nous allons le diriger vers un comité de justice réparatrice dirigé par des bénévoles. » Et ensemble, par le biais de ce comité, vous pourrez décider que cet enfant fera des travaux communautaires. Il va rédiger une dissertation. Il va nous dire ce qu’il veut faire de sa vie et pourquoi il veut aller à l’université, au collège, ou peu importe. » J’ai siégé à ces comités et encore une fois, je précise qu’ils ne sont pas parfaits non plus, mais cette approche est bien meilleure que d’envoyer cette enfant dans le système, ce qui changera dramatiquement son parcours de vie et fera en sorte qu’il aura un casier judiciaire, surtout s’il va en prison.
Donc, ces comités de justice réparatrice sont des organismes bénévoles et vous pouvez vous joindre à eux. Il y a probablement un comité local près de chez vous. Une représentante du ministère de la Justice a assisté à l’une de nos rencontres, et elle a déclaré qu’il y a dix ans, on comptait 140 comités en Alberta. En 2024, on en compte 40. J’ignore la raison pour laquelle leur nombre a diminué, mais nous avons besoin de personnes de la communauté pour faire du travail communautaire, et de soutien communautaire. Je crois que c’est la réponse à tout cela, on ne peut pas tout déléguer aux prisons. Il est bien commode de rejeter la responsabilité pour tout ce qui se passe sur les prisons, mais le problème va bien au-delà des prisons, et c’est, selon moi, une façon positive de conclure. Oui, nous sommes d’accord pour dire que la prison est un endroit horrible. Les prisons sont la source de nombreux problèmes, ne contribuent pas à améliorer les gens, mais ce n’est pas uniquement un problème de prisons […] quand il est question d’incarcération de masse des Autochtones, de sécurité publique et de santé et des problèmes de drogues et de la société, le problème est vraiment beaucoup, beaucoup plus grand que les prisons. On ne peut pas rejeter la responsabilité pour tout cela uniquement sur les prisons, même si elles posent un nombre considérable de problèmes. C’est une question qui touche les services de santé mentale, l’éducation et les services à l’enfance dans notre pays. Il ne s’agit pas uniquement d’un problème de prison.
Denise Webb : Eh bien, merci pour votre intervention, pour cette note positive en conclusion et pour le fait que nous pouvons proposer certaines avenues aux personnes qui souhaitent s’investir et s’impliquer. C’est un aspect sur lequel je vais me pencher, le comité de justice réparatrice présent dans mon entourage.
Alors merci, Justin. Un grand merci de vous être joint à nous pour cet épisode de notre balado et d’avoir partagé votre expertise, vos connaissances et vos travaux de recherche et d’avoir précisé ce qui doit être fait sur cet enjeu de première importance.
Justin Tetrault : Oui, bien sûr. Merci de m’avoir invité.