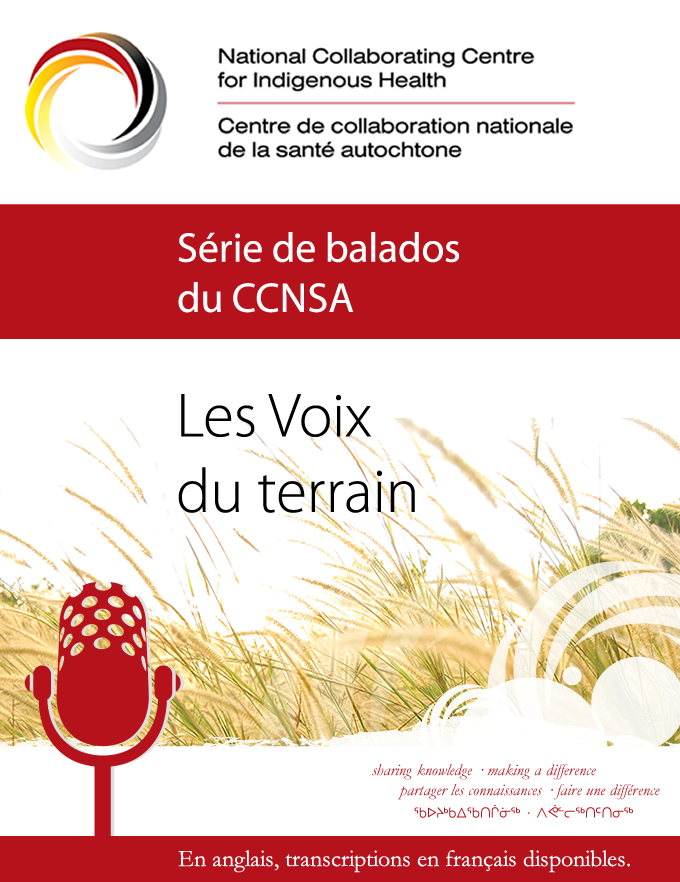 Série de balados Les Voix du terrain
Série de balados Les Voix du terrain
Les Voix du terrain
Bienvenue aux Voix du terrain, une série de balados produite par le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone (CCNSA). Le CCNSA met l’accent sur la recherche innovante et les initiatives communautaires visant à promouvoir la santé et le bien-être des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada.
Épisode 33 – Désincarcération et santé : éliminer les barreaux pour un changement systémique – Partie 3 : le projet de justice réparatrice wîyasôw iskweêw
Description
Désincarcération et santé : éliminer les barreaux pour un changement systémique est une minisérie dans le cadre des Voix du terrain. Elle a inspiré le rapport du CCNSA Derrière les barreaux : la surincarcération des Autochtones dans le système de justice pénale canadien, ses conséquences sur la santé et les possibilités de désincarcération. Ce rapport fait état de la crise de santé publique découlant de la surincarcération de membres des Premières Nations, d’Inuits et de Métis dans le système pénal canadien et explore des avenues pour la désincarcération grâce à des solutions de recherche fondées sur la justice communautaire, notamment des programmes de déjudiciarisation, des tribunaux autochtones et des pavillons de ressourcement dirigés par des Autochtones. La surincarcération a à la fois des effets immédiats et des répercussions négatives à long terme sur la santé et est un déterminant de la santé. Cette minisérie permet d’entendre des experts dans le domaine sur les réalités et les bienfaits des solutions de rechange qu’apporte la justice communautaire, leur lien avec la santé et ce qui serait nécessaire pour amener des changements systémiques et remédier aux injustices actuelles, qui se traduisent par une surincarcération des Autochtones à travers le pays.
Désincarcération et santé : éliminer les barreaux pour un changement systémique – 3e partie : le projet de justice réparatrice wîyasôw iskweêw. Dans cet épisode, nous nous entretenons avec la juge Anna Loparco de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta, et avec la juge en chef adjointe Joanne Durant et la juge Michelle Christopher, toutes deux de la Cour de justice de l’Alberta et avec notre coanimatrice Andrea Menard, avec qui nous aborderons la mise sur pied du programme de justice réparatrice wîyasôw iskweêw, annexé au tribunal. Nous nous renseignerons sur les liens importants du programme avec la responsabilisation des contrevenants et avec la santé, le mieux-être et la guérison des victimes et nous discuterons aussi des aspirations pour l’avenir de ce programme et des éléments nécessaires pour susciter le changement et prioriser le recours aux lois et aux pratiques juridiques autochtones dans le système de droit pénal.
Écouter sur SoundCloud (en anglais)
Vous pouvez parcourir la version web de la transcription en français du balado plus bas sur cette page, ou encore télécharger la transcription en français en format PDF.
Télécharger une liste de ressources liées au balado (PDF)
Biographies

La juge Anna Loparco est membre éminente de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta, où elle a été nommée le 8 mars 2019. La juge Loparco a étudié à la School of Business de l’Université de l’Alberta, où elle a obtenu un baccalauréat en commerce en 1995. Elle a ensuite travaillé au Canadien national pendant cinq ans avant d’entreprendre des études en droit à la faculté de droit de l’Université McGill, où elle a suivi le programme conjoint bilingue en common law et droit (BCL/JD) et obtenu son diplôme en 2002. Elle y a aussi obtenu une maîtrise en administration des affaires (MBA) en 2003. Elle a été admise au barreau du Québec, à celui de New York et à celui de l’Alberta.
En tant qu’avocate, madame Loparco a travaillé au cabinet Fraser Milner Casgrain s.r.l. (devenu par la suite Dentons s.r.l.), où elle a acquis le statut d’associée, pratiquant dans un large éventail de domaines du droit, notamment en propriété intellectuelle, droit constitutionnel, droit de la famille, droit successoral, droit de l’éducation, droit administratif, responsabilité professionnelle, droit commercial, des assurances et de la protection de la vie privée. Elle a comparu devant de tous les paliers de l’appareil judiciaire, y compris devant la Cour suprême du Canada, et est l’auteure de nombreux articles, notamment sur les questions du rôle des témoins experts et celui des avocats de l’enfant. Elle a été avocate à l’Office of the Child and Youth Advocate (bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse) en Alberta pendant plus de 15 ans et a joué un rôle clé dans la mise sur pied d’une nouvelle structure pour la représentation des enfants, laquelle vise à garantir leur droit de participer aux procédures qui les concernent. Elle a représenté des enfants dans des affaires d’abus sexuel et de violence physique, et a assuré la liaison avec les tribunaux de la province. Elle a livré des conseils lors d’enquête sur le décès ou les blessures graves d’enfants confiés aux services sociaux et formulé des recommandations de changements visant l’amélioration des services à l’enfance en Alberta.
La juge Loparco est cofondatrice et coprésidente du projet de justice réparatrice Beverley Browne – wîyasôw iskweêw –, auquel participent des juges de la Cour du Banc du Roi et de la Cour de justice de l’Alberta, des procureurs de la Couronne, des avocats de la défense, des groupes autochtones, des groupes de défense des droits des victimes, des intervenants en justice réparatrice, des services de police et de nombreux autres intervenants de la communauté. Bien qu’il se concentre à l’heure actuelle sur les affaires pénales, le projet vise à élargir éventuellement les pratiques en justice réparatrice aux contextes du droit familial et du droit civil.
La juge Loparco a donné beaucoup de son temps comme bénévole dans la communauté. Elle a pris en charge bénévolement de nombreux dossiers où elle représentait des enfants dans des affaires d’abus sexuel et des personnes aux prises avec des maladies mentales. Elle œuvre régulièrement comme avocate de service pour l'organisme Pro Bono Alberta, et comme amicus curiæ. Depuis 2020, madame Loparco préside le Comité directeur sur le français et l’interprétation de la Cour du Banc du Roi et est régulièrement appelée à présider des affaires en français, notamment des procès avec jury.

La juge en chef adjointe Joanne Durant est née et a grandi à Ottawa, en Ontario. Elle a obtenu son baccalauréat de l’Université York, et est diplômée en droit de l’Osgoode Hall Law School. Après deux ans comme avocate de la défense à Toronto, elle a joint le service des poursuites. Une fois installée à Calgary, elle a travaillé au service des poursuites de l’Alberta où elle a été procureure générale adjointe jusqu’à sa nomination à la magistrature, en 2011. Mme Durant a été chargée de cours à temps partiel à l’Université Mount Royal, à l’Université Lethbridge et à la faculté de droit de l’Université de Calgary. En 2017, elle est nommée chef adjointe de la chambre criminelle de Calgary et les environs, puis juge en chef adjointe de la Cour de justice de l’Alberta en 2021.
La juge en chef adjointe Durant assure la supervision de tous les tribunaux spécialisés et des tribunaux autochtones pour la Cour de justice. Elle œuvre en mentorat des juges au programme judiciaire de traitement des troubles liés à l’utilisation de substances, où elle siège régulièrement. Elle est aussi présidente des comités d’éducation et de gestion des dossiers criminels.
Mme Durant est mère de cinq enfants et donne chaque semaine de son temps comme bénévole à son chapitre local de la société de protection des animaux.
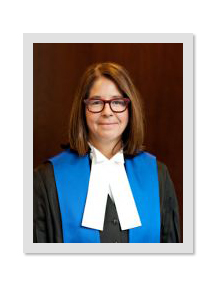
Avant d’être nommée première femme juge à la Cour provinciale de Medicine Hat, en Alberta, en 2018, l’honorable juge Michelle Christopher, c. r., était professeure de droit, médiatrice et directrice de la clinique juridique bénévole. Elle a pratiqué en droit familial et pénal. En 2016, elle a reçu le Prix pour service méritoire exceptionnel de l’Association du Barreau canadien et de la Law Society of Alberta pour son service à la communauté. Elle a été nommée conseillère de la reine en 2018. Mme Christopher siège maintenant comme juge à la chambre criminelle de la Cour de justice de l’Alberta à Calgary, en Alberta. Passionnée par l’accès à la justice, elle travaille aussi avec grand enthousiasme à faire connaître la justice réparatrice aux personnes impliquées avec le système de justice en Alberta et ailleurs au pays. La juge Christopher consacre aussi beaucoup de temps et d’énergie à des initiatives d’éducation en matière judiciaire, à son tribunal et par le biais de travail bénévole au conseil d’administration de l’Alberta Provincial Justices Association, de l’Association canadienne des juges de cours provinciales et de la section canadienne de l’Association internationale des femmes juges.

Andrea Menard – Je suis une personne métisse associée au gouvernement métis Otipemisiwak et je travaille sur le territoire visé par le Traité no 6 à amiskwacîwâskahikan (Edmonton). Ma famille est originaire de la colonie de la rivière Rouge, maintenant dissoute, dans le territoire du Traité no 1. Notre lignée métisse porte les noms de famille Bruneau, Carrière et Larocque.
Je suis honorée d’avoir été nommée parmi les cinq avocats les plus influents de 2023 par le magazine CIO Times et parmi les 25 avocats les plus influents de 2022 par Canadian Lawyer. Ces distinctions témoignent de mon profond engagement à collaborer avec les nations autochtones dans le cadre des traités 4, 6, 7, 8 et 10, notamment des collaborations avec le gouvernement métis Otipemisiwak.
Mon parcours personnel comme personne métisse oriente mon ambition de réformer les politiques pédagogiques et juridiques en milieu de travail grâce à l’inclusion des lois autochtones, et il est enrichi par mes études de doctorat en théorie de la dominance sociale et en pluralisme juridique à l’Université Royal Roads dans le programme de doctorat en sciences sociales.
En tant que chargée de cours de droit à la Faculté de droit de l’Université de Calgary et à la Osgoode Hall Law School, je développe et donne des cours novateurs tels que « Reconciliation and Lawyers » (réconciliation et avocats) (LAW 693) et « In Search of Reconciliation Through Dispute Resolution » (à la recherche de la réconciliation par le règlement des différends) (ALDR 6305). De plus, je suis conseillère pédagogique au développement pour l’indigénisation des programmes et des pédagogies au Centre for Teaching and Learning de l’Université de l’Alberta, le centre d’enseignement et d’apprentissage.
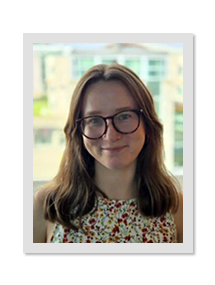
Denise Webb est associée de recherche au Centre de collaboration nationale de la santé autochtone. Elle est titulaire d’une maîtrise en sciences de la recherche sur les services de santé, avec une spécialisation en politique de santé et en santé autochtone, de l’Institut des politiques, de la gestion et de l’évaluation de la santé de l’Université de Toronto. Ses recherches portent sur l’intersection et la relation entre les politiques de santé et la santé publique des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Denise Webb est d’origine irlandaise et écossaise et est une aspirante alliée, travaillant à orienter les efforts de décolonisation des systèmes de santé et de la recherche sur les politiques.
Transcription
Denise Webb : Bienvenue aux Voix du terrain, une série de balados produite par le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, le CCNSA. Le Centre s’intéresse à la recherche novatrice et aux initiatives communautaires qui visent à promouvoir la santé et le bien-être des populations des Premières Nations, des Inuits et des Métis partout au Canada.
– Musique –
Bonjour et bienvenue à Désincarcération et santé : éliminer les barreaux pour un changement systémique, une minisérie dans le cadre de Voix du terrain. Je m’appelle Denise Webb. Je suis descendante de colons irlandais et écossais et je vis en tant qu’invitée sur le territoire traditionnel non cédé des Lheidli T’enneh, au nord de la Colombie-Britannique. Je suis associée de recherche au Centre de collaboration nationale de la santé autochtone et je coanimerai cette minisérie en compagnie d’Andrea Menard.
Andrea Menard : Bonjour, tânsi, hello tout le monde. Et merci, Denise. Je suis métisse et juriste de profession, anticolonialiste et originaire de la colonie de la rivière Rouge, où les noms de mes familles sont Bruneau, Carrière et LaRocque. Je suis également titulaire d’une carte de membre du gouvernement métis d’Otipemisiwak, le gouvernement de la nation métisse de l’Alberta. J’habite présentement sur le territoire non cédé du Traité 6 et sur les terres de la région de la patrie métisse.
Je possède plus de 20 années d’expérience en droit et dans les secteurs gouvernementaux et juridiques des organismes sans but lucratif et du droit universitaire et réglementaire. J’ai tissé des liens dans tout le territoire maintenant connu sous le nom de Canada avec des Autochtones et des nations et des organisations autochtones, de même qu’avec des professionnels et des partenaires universitaires non autochtones avec qui je collabore dans le cadre de bon nombre de programmes et d’initiatives de décolonisation et de réconciliation.
Denise Webb : Merci, Andrea. Désincarcération et santé : éliminer les barreaux pour un changement systémique est une minisérie inspirée d’un rapport que j’ai rédigé et qui a été publié en 2024 par le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone sous le titre Derrière les barreaux – La surincarcération des Autochtones dans le système de justice pénale canadien, ses conséquences sur la santé et les possibilités de décarcération. Ce rapport visait à contribuer à l’information sur la crise de santé publique que constitue la surincarcération des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans le système pénal canadien. Ce rapport explore aussi des avenues pour la désincarcération grâce à des solutions de rechange fondées sur la justice communautaire, notamment des programmes de déjudiciarisation, des tribunaux autochtones et des pavillons de ressourcement dirigés par des Autochtones.
La surincarcération a des effets négatifs immédiats et à plus long terme sur la santé et constitue un déterminant de la santé. Cette minisérie de balados offre une occasion d’écouter des experts de la question et des personnes ayant de l’expérience de travail dans le système pénal et d’en apprendre un peu plus sur cette question, sur les changements qui sont nécessaires et sur la façon dont les lois et les principes juridiques autochtones peuvent être respectés et maintenus en vue de favoriser l’émergence d’un système de justice distinct, dirigé par les Autochtones.
Je suis incroyablement reconnaissante à Andrea, qui a gracieusement accepté de soutenir le CCNSA en dirigeant et orientant les travaux pour la réalisation de cette minisérie; en partageant ses connaissances, son expertise juridique et sa passion pour cette question. C’est un honneur de vous voir avec nous, Andrea.
Andrea Menard : Aucun problème, Denise. C’est un plaisir pour moi d’être ici et de coanimer avec vous, et d’avoir l’occasion de mener ensemble des entrevues avec des personnes formidables qui travaillaient à éliminer les obstacles systémiques et à entraîner des changements qui transforment le domaine pénal, changements qui ne sont pas toujours bien compris ou encore connus pour le moment.
Alors, j’apprécie beaucoup l’espace que le CCNSA a offert à cet important balado. Mon objectif est de créer une dynamique en apprenant ce que font les autres et de faire en sorte que les choses avancent de la bonne façon.
– Musique –
Denise Webb : L’épisode d’aujourd’hui traite du projet pilote de justice réparatrice wîyasôw iskweêw, en Alberta. Pour en savoir plus à ce sujet, nous nous sommes entretenus avec l’honorable juge Anna Loparco de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta, avec l’honorable juge en chef adjointe Joanne Durant et avec l’honorable juge Michelle Christopher de la Cour de justice de l’Alberta.
Cet épisode s’accompagne d’un avertissement relatif à son contenu. Il pourrait en effet déclencher ou entraîner des sentiments de détresse chez certaines personnes de notre auditoire. On y expose des cas d’abus sexuel et de consommation de substances. Pour obtenir de l’aide, communiquez avec la Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être, à www.espoirpourlemieuxetre.ca ou au 1 855 242-3310. Une ligne d’écoute téléphonique pour tout ce qui concerne les pensionnats autochtones est aussi offerte en tout temps au 1 866 925-4419. Veuillez demeurer vigilants durant votre écoute.
– Musique –
Denise Webb : Merci à toutes de vous être joints à nous et de prendre de votre temps pour cet entretien. L’honorable juge Anna Loparco, l’honorable juge en chef adjointe Joanne Durant et l’honorable juge Michelle Christopher s’entretiendront avec nous et nous entendrons aussi notre coanimatrice Andrea Menard dans cet épisode, puisqu’Andrea a joué un rôle de premier plan dans l’orientation de ces travaux, et a mis sur pied et coprésidé le sous-comité de la fondation autochtone, l’Indigenous Foundation, sur le projet pilote de justice réparatrice wîyasôw iskweêw.
Il est tellement stimulant de vous avoir toutes avec nous aujourd’hui. Peut-être pourriez-vous, les juges qui sont avec nous, commencer par vous présenter et nous parler un peu de votre parcours et des types de causes que vous entendez, pour les auditeurs qui ne sont peut-être pas familiers avec les divers termes.
Juge Anna Loparco : Merci, et merci également pour cette présentation et pour l’invitation à être parmi vous aujourd’hui. C’est un honneur de vous parler du projet auquel nous participons, le projet pilote de justice réparatrice wîyasôw iskweêw.
Donc, je suis la juge Anna Loparco et je siège à la Cour du Banc du Roi à Edmonton. Je siège dans le cadre de divers types d’affaires, aussi bien en droit civil que familial ou pour des affaires criminelles. Des affaires criminelles devant un juge seul ou avec jury.
Quelques mots sur mon parcours. J’étais dans un grand cabinet de la région d’Edmonton. J’ai aussi travaillé à Montréal, où j’avais fait mes études. Je suis donc membre du barreau de l’Alberta et de celui du Québec. Avant d’être nommée à la magistrature, j’ai exercé le droit dans un large éventail de domaines, notamment en protection de la jeunesse, et dans une variété de dossiers constitutionnels, d’affaires liées aux écoles et au droit des sociétés. Donc, j’ai fait un peu de tout. Et dans mes temps libres – j’en avais quand même très peu, vous vous en doutez bien –, j’ai travaillé dans la communauté avec un organisme œuvrant en justice réparatrice et offrant principalement des services aux jeunes, mais qui comporte aussi une composante pour adultes. J’ai été tellement émue et inspirée par les résultats obtenus auprès des jeunes impliqués dans le système de justice pénale que je m’étais dit alors que, si jamais j’étais nommée juge, j’essaierais d’en faire un de mes projets afin que la justice réparatrice puisse s’étendre et être offerte dans le cadre d’un projet de tribunal.
Et c’est exactement ce que nous avons fait; je suis devenue coprésidente du projet de justice réparatrice. Il s’agissait au départ d’un projet pilote et je suis heureuse de dire aujourd’hui qu’il s’agit d’un projet permanent.
Denise Webb : Merci. Juge en chef adjointe Joanne Durant?
Juge en chef adjointe Joanne Durant : Merci et merci également de m’avoir invitée aujourd’hui. Nous sommes vraiment heureuses d’avoir cette occasion de parler de ce projet.
Prior to being appointed to the bench, I had a lengthy career in the Crown Prosecution Service, and I was originally appointed in the Criminal Division of the Court of Justice in 2011. I sit in Calgary. I became the Assistant Chief Justice of the Calgary and Regional Divisions in 2017, and then the Deputy Chief Justice of the Court in 2021. As the Deputy Chief Justice of the Court, I have – amongst a number of other things – I have oversight of all of our Indigenous and therapeutic courts, specialized courts in the province.
Ce qui m’a amenée à participer à ce projet est que je me suis rendu compte qu’un tribunal peut faire beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qu’il ne peut pas faire, et beaucoup de travail est à faire en dehors des procédures judiciaires. La justice réparatrice forme justement une part importante de ce processus.
Denise Webb: Merci. Et vous, juge Michelle Christopher?
Juge Michelle Christopher : Bonjour. Je suis vraiment heureuse d’être ici. Je viens, bien sûr, du domaine du droit, mais davantage du côté universitaire. J’ai exercé dans les domaines du droit familial et du droit pénal, avant de me diriger vers l’enseignement à l’Université de Calgary, tout en travaillant pour l’accès à la justice par le biais de cliniques juridiques étudiantes et de travail bénévole.
Mon intérêt pour la justice réparatrice vient de l’époque où je travaillais comme médiatrice. Je siège principalement à Calgary, à la chambre criminelle, mais je travaille aussi dans les tribunaux régionaux des environs de Calgary. Il y a en tout 11 points de service dans le réseau que nous desservons à partir de Calgary, où nous entendons aussi des affaires de droit civil et de la famille. En œuvrant au sein de divers programmes intégrés au tribunal en vue d’offrir des services de médiation dans les tribunaux de l’Alberta, et en travaillant avec les jeunes, j’ai réalisé que la justice réparatrice offrait un grand potentiel en tant que moyen, pour le système de justice, de répondre aux gens en faisant appel directement aux motifs qui les avaient amenés à enfreindre la loi et à se retrouver devant les tribunaux.
So, thank you very much for including me in this important work. I look forward to what comes next as we continue our initiatives in restorative justice.
Andrea Menard : Je me demandais si vous pouviez aussi nous expliquer en quoi consiste le projet de justice réparatrice wîyasôw iskweêw. Madame la juge Anna Loparco?
Juge Anna Loparco : Eh bien, il s’agit d’un projet que nous avons amorcé il y a un peu plus de cinq ans maintenant. Je vais diviser votre question en deux, car je veux d’abord expliquer en quoi consiste la justice réparatrice, puis comment nous en sommes arrivés au projet de justice réparatrice appelé wîyasôw iskweêw.
Donc, la démarche de justice réparatrice est véritablement un terme emprunté aux Autochtones. Il est utilisé depuis des temps immémoriaux dans les communautés autochtones, et bien qu’on l’utilise depuis des décennies au Canada, tant pour des affaires autochtones que non autochtones, je dois dire, en premier lieu, que nous voulons continuer d’en honorer les origines autochtones et de veiller à ce que toute approche en matière de justice réparatrice soit sensible sur le plan culturel et adaptée aux participants dans chaque cas.
Alors, comme nous le verrons plus tard en ce qui a trait au développement de ce projet – c’est le cas pour vous, Andrea, qui y avez participé étroitement – nous cherchions à répondre aux appels à l’action de la CVR et plus précisément à obtenir l’avis du sous-comité de l’Indigenous Foundation sur la façon d’aller de l’avant en abordant le tout non pas dans une optique pan-autochtone, mais plutôt en élaborant des politiques visant à nous assurer que la démarche respecte les traditions particulières des communautés concernées.
Mais revenons au concept de justice réparatrice; il cherche à réunir la victime, le contrevenant et les membres de la communauté, qui sont soutenus et participent de façon volontaire à une discussion, à un dialogue sur ce qui se passe. Comme chacun sait, dans le système de justice pénale, ce n’est pas ce qui se produit. En fait, c’est tout le contraire : souvent, lorsqu’une personne a un avocat, c’est la défense qui participe. Il est dans l’intérêt primordial de l’accusé de garder le silence. Il bénéficie de la présomption d’innocence et du droit de garder le silence, mais souvent, cela ne permet pas de s’attaquer aux racines du problème. Souvent, les victimes souhaitent obtenir une explication, mais ne l’obtiennent jamais. Elles ont la possibilité, bien sûr, de présenter leur témoignage et de faire une déclaration en tant que victime, mais, en fin de compte, qu’il en résulte une condamnation ou un acquittement, les gens ont une impression de vide et n’ont pas de réponse; ils ne savent tout simplement pas ce qui s’est passé. Des familles peuvent être brisées. Des communautés essaient de comprendre comment elles pourront aller de l’avant, et il n’y a pas de dialogue qui s’installe. Donc, la justice réparatrice fait appel à un médiateur neutre ou à un gardien. Elle met les diverses parties à contribution, précise en quoi consistent les torts causés, expose les répercussions et recommande ce qui doit être fait pour changer ou corriger les choses et guider les parties vers la voie de la guérison et du mieux-être. Donc, les grands principes de la justice réparatrice sont évidemment de reconnaître les torts causés, qu’il doit y avoir participation volontaire, que les enjeux de sécurité soient pris en charge et, bien sûr, que les parties aient des attentes raisonnables pour ce qui est des résultats.
Voilà donc en quoi consiste la justice réparatrice en quelques mots. Comme je l’ai mentionné précédemment, en raison de mon parcours auprès des jeunes dans le contexte de la justice réparatrice, je souhaitais que cette pratique soit élargie. Et j’ai eu la chance de rencontrer la juge Beverly Brown, maintenant décédée. Or, en 2019, peu de temps après ma nomination, soit un mois après l’avoir rencontrée, nous avions toutes deux cette passion pour la justice réparatrice. Et quiconque la connaissait savait qu’elle était la première cheffe au Nunavut et qu’elle défendait énergiquement les droits des Autochtones et les droits des minorités, de façon générale, devant les tribunaux. Donc, nous avions discuté de la façon d’intégrer la justice réparatrice aux procédures judiciaires dans les affaires pénales. Puis le comité a été mis sur pied en 2019 et nous avons commencé à relier les points entre eux et à réunir les gens. Andrea, je crois que vous avez été l’une des premières personnes autour de la table. Avant même le lancement du projet, nous avions un comité de 100 personnes, des membres de la communauté, et je crois que Michelle vous en dira un peu plus à ce sujet, alors je ne m’étendrai pas trop là-dessus, mais nous avons réalisé une vaste consultation.
Nous avons donc lancé officiellement le projet pilote en 2022. C’était durant la COVID, et c’était aussi devant le tribunal autochtone de Calgary. L’inauguration a commencé par une cérémonie de purification par la fumée. Les ministres de la Justice fédéral et provincial étaient présents et ont pris la parole à cette occasion; bon nombre de communautés autochtones étaient aussi impliquées et ont pu relater leur expérience de la justice réparatrice. Ce fut un événement vraiment marquant. Et c’était le lancement officiel.
Après le décès de Beverly Brown, nous avons désigné le comité sous le nom de projet de justice réparatrice wîyasôw iskweêw, ce qui signifie, en gros, « la femme qui se lève pour la justice ». Nous avions organisé une cérémonie spirituelle crie pour l’attribution de ce nom à Beverly avant son décès et nous pensions qu’il était approprié de nommer le comité en son honneur.
Mais je vais m’arrêter ici parce qu’il y a bien d’autres choses à dire et je ne voudrais pas accaparer tout le temps prévu, alors je vais donc vous céder la parole, Andrea.
Andrea Menard : Madame la Juge en chef adjointe Joanne Durant, que pouvez-vous nous dire à ce sujet?
Juge en chef adjointe Joanne Durant : Merci beaucoup, Andrea. Je crois que la juge Loparco a résumé le projet d’excellente façon. Je n’ai pas grand-chose d’autre à ajouter, si ce n’est de réitérer ses commentaires voulant que, comme je l’ai dit précédemment, la Cour peut faire beaucoup de choses, mais qu’il y a aussi beaucoup de choses que la Cour ne peut pas faire et qu’il ne fait pas de doute que les déclarations des victimes seront entendues – s’il y a effectivement condamnation, ce qui n’arrive pas toujours pour diverses raisons. Les déclarations à propos des effets sur la communauté sont aussi permises dans certains cas, mais encore une fois, bien que cela permet à la Cour d’entendre parler des répercussions des gestes qu’a posés le contrevenant, cela ne laisse quand même pas beaucoup d’espace pour quelque forme de guérison que ce soit pour les parties impliquées – ce travail doit vraiment se faire à l’extérieur du système judiciaire. Je crois que plusieurs des personnes qui, parmi nous, ont été impliquées dans des affaires criminelles devant la Cour ont réalisé il y a longtemps que nous passons à l’affaire suivante, mais que les effets du comportement d’un contrevenant demeurent pour les personnes qui ont été touchées par l’incident. Ce projet leur permet réellement de rencontrer le médiateur et de parler des répercussions des gestes posés par le contrevenant, mais aussi de ce qui a fait en sorte que cette personne s’est retrouvée à poser de tels gestes.
Alors, comme plusieurs de nos tribunaux thérapeutiques, de guérison et de mieux-être, cette démarche permet vraiment d’aller jusqu’aux causes profondes qui ont fait en sorte que l’acte criminel s’est produit au départ. Et nous espérons qu’avec cette compréhension, la guérison puisse non seulement survenir, mais que la récidive puisse aussi être moindre si nous nous attaquons aux causes profondes qui ont entraîné cette personne jusqu’à cette étape de vie.
Denise Webb : Merci à vous deux pour les explications. Je suis vraiment heureuse de savoir comment le projet de justice réparatrice et la démarche qui en découle permettent à la personne contrevenante, à la communauté et aux victimes de s’engager sur la voie de la guérison et du mieux-être.
Ma prochaine question s’adresse à la juge Anna Loparco. Je sais que vous nous avez déjà relaté l’historique du projet et expliqué comment il a vu le jour grâce au travail du comité. Je me demande si vous pouvez nous brosser, peut-être, un tableau du fonctionnement du projet de façon générale et nous parler de certains des principes interreliés qui le caractérise?
Juge Anna Loparco : Oui, je peux certainement faire ça. De façon générale, il existe deux types de mesures : les premières sont pour la déjudiciarisation, pour les délits de moindre importance, et le deuxième type comprend les mesures précédant la détermination de la peine. Il est important de les distinguer parce que nous connaissons tous trop bien le problème tragique de la surincarcération auquel nous sommes confrontés tous les jours dans notre système judiciaire et dans notre système carcéral. Il nous faut adopter une approche individualisée en matière de détermination des peines, et la justice réparatrice nous permet de le faire parce que nous sommes mieux informés avant d’imposer une peine et cela nous permet de trouver des solutions qui, en fin de compte, règlent des enjeux sous-jacents lorsque nous comprenons mieux les causes profondes ayant mené à un acte criminel.
Deuxièmement, nous devons prendre conscience que toutes les victimes d’actes criminels ne veulent pas nécessairement aller devant les tribunaux. Cela nous offre un système de justice aux portes multiples, qui permet de rediriger certaines affaires, lorsque cela s’avère approprié, vers d’autres forums de résolution des différends. À titre d’exemple, je me permets de citer les victimes d’agression sexuelle, en particulier, que nous avons entendues haut et fort. Comme vous le savez peut-être, les statistiques sont terribles. Seules 5 % des agressions sont signalées et de ce nombre, une très faible proportion mène à une condamnation et au bout du processus, personne n’est satisfait. Ce que permet la justice réparatrice est qu’une fois la responsabilité acceptée, on peut agir et améliorer la justice pour les participants, et ce, de manière pertinente pour les parties en leur permettant d’obtenir les services dont ils ont besoin pour briser le cycle de la criminalité et des traumatismes et tenter de dénouer les problèmes affectifs sous-jacents à la source de l’acte criminel.
Troisièmement, je voulais mentionner brièvement que le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial a engagé tous les gouvernements à augmenter le recours à la justice réparatrice dans des affaires criminelles. Alors, comme je le disais précédemment, en plus de répondre aux appels à l’action, nous répondons aussi à leur mandat. On compte plus de 240 organismes offrant des services à travers le Canada et environ 15 en Alberta figurent sur notre liste. Alors, quand nous sommes à la Cour et que nous avons une demande pour être dirigés vers la justice réparatrice à des fins de déjudiciarisation ou avant la détermination d’une peine, les personnes peuvent consulter cette liste, puis nous ajournerons simplement l’affaire. Nous sommes ensuite en mesure d’explorer des solutions adaptées au contexte pour les affaires impliquant la communauté au sens large et les personnes concernées, et de tenter de réduire les taux de récidive et, en fin de compte, les coûts pour le système de justice.
Denise Webb : Parfait. Merci, juge Loparco. J’aimerais maintenant céder la parole à Andrea, qui nous en dira un peu plus sur le fonctionnement du comité. Comment s’est déroulée la coprésidence du sous-comité de la fondation autochtone sur le projet? Comment s’est passé le processus de consultation? Qui avez-vous réuni et que comprenait ce processus?
Andrea Menard : Merci, Denise. Oui, c’était un honneur de coprésider le sous-comité de la fondation autochtone avec Anna et Michelle; elles coprésidaient le projet de justice réparatrice, qui était à l’époque un projet pilote. Ils nous ont laissé une grande marge de manœuvre en tant qu’Autochtones. Nous savons profondément ce qui se produit dans nos communautés lorsque nous interagissons avec le système de justice colonial. Ils nous ont donc donné une latitude considérable et beaucoup de moyens – beaucoup d’espace pour faire ce que nous faisons de mieux : comme nous sommes autochtones, nous souhaitons aider les Autochtones et nous voulons que leur voix soit prise en compte, parce qu’à de nombreuses reprises, ces voix ont été absentes. C’était donc un honneur et un privilège pour moi de coprésider le sous-comité de la fondation sur le projet de justice réparatrice.
J’ai donc décidé de coprésider avec une procureure de la Couronne métisse de l’Alberta. Elle et moi présidions les rencontres ensemble. Et ce qui comptait pour nous était de réunir tous les Autochtones, et c’est très difficile, vous savez, parce qu’il y a beaucoup de nations autochtones. Il y a aussi des organisations métisses, la Métis Nation de l’Alberta. Et des Autochtones vivant en milieu urbain, de même que des avocats et des juges autochtones. Alors, qui allions-nous réunir?
J’avais donc un peu d’historique et de connaissances du travail en justice réparatrice dans les tribunaux lorsque j’ai commencé à travailler pour l’aide juridique en Alberta en tant que directrice des relations avec les Autochtones. De 2018 à 2020, j’ai parcouru l’Alberta, j’ai pu voir comment fonctionnaient les tribunaux, j’ai appris à connaître un peu le terrain et j’ai pu rencontrer des comités autochtones de justice réparatrice. Il était vraiment important de veiller à ce que des avocats autochtones fassent partie du sous-comité, de même que des aînés et des membres des nations engagés dans la justice réparatrice. C’était vraiment important, tout comme il était très important de compter des membres parmi les Autochtones de milieux urbains et des gens impliqués dans le système de justice, d’entendre leur voix et de savoir ce qu’ils aimeraient voir. C’était une démarche formidable. Elle est d’ailleurs toujours en cours et nous continuons de tenter de la renforcer, alors que nous évoluons vers cette ère de justice réparatrice qui est maintenant la nôtre. Comme le disait Anna précédemment, la justice réparatrice a des racines autochtones. Donc, depuis des temps immémoriaux sur ces terres, les Autochtones y ont eu recours de cette façon. Il est donc tout à fait logique que le projet de justice réparatrice wîyasôw iskweêw repose sur une perspective autochtone et s’intéresse aux racines profondes de chaque affaire. Le processus de consultation était large et varié. Il a été réalisé à l’intérieur du groupe du sous-comité et dans un groupe plus large comptant 100 personnes, qui étaient présentes et planifiaient les stratégies en vue de définir jusqu’où nous irions avec ce projet.
Le processus de consultation était large et varié. Il a été réalisé à l’intérieur du groupe du sous-comité et dans un groupe plus large comptant 100 personnes, qui étaient présentes et planifiaient les stratégies en vue de définir jusqu’où nous irions avec ce projet.
Donc, lors du lancement, plus tôt en 2022, comme l’expliquait Anna, il y avait Saddle Lake Restorative Justice et le conseil tribal Kee Tas Kee Now, avec leur programme de justice réparatrice. Nous avions l’aîné John Bigstone du programme de justice de la nation crie Bigstone et nous avions des aînés qui nous invitaient et qui faisaient les choses correctement, en commençant par une cérémonie de purification par la fumée. Et bien sûr, nous avions un programme de lancement vraiment phénoménal et je suis très fière de ce que nous avons fait jusqu’à maintenant.
Denise Webb : Incroyable. Merci. Merci de nous avoir expliqué tout cela.
Notre prochaine question – je me demande si nous ne devrions pas la poser à la juge en chef adjointe Joanne Durant : pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste cette nouvelle politique de la Couronne relativement au programme et comment celui-ci fonctionne dans les tribunaux?
Juge en chef adjointe Joanne Durant: Merci, je serai heureuse de le faire. La création de la politique de la Couronne par les services des poursuites, tant le service provincial que le service fédéral des poursuites, a joué un rôle crucial dans la mise sur pied du projet.
Il était important de s’assurer qu’il y ait une structure en place afin d’assurer une cohérence et une transparence à travers la province également, alors nous commencerons par dire que toutes les affaires criminelles sont admissibles à être dirigées vers la justice réparatrice. Pour certaines affaires, d’autres étapes doivent être prises en compte – je vous en dirai un peu plus dans un moment. Il est certain que des accusations doivent avoir été déposées pour qu’une affaire soit admissible à participer au projet. Alors, même si la justice réparatrice est certainement disponible avant l’inculpation, est-ce que le service de police ou les contrevenants et les victimes devraient procéder de cette façon au lieu que le contrevenant soit inculpé? La démarche dont il est question ici commence à la suite de l’inculpation.
Il y a donc deux avenues pour les renvois : la première est au tout début, avant que toute étape digne de ce nom ait été franchie dans une affaire, et vous avez entendu la juge Loparco en faire mention. Il s’agit de la voie de la déjudiciarisation. La deuxième peut être utilisée une fois que la personne a été reconnue coupable ou a plaidé coupable, mais avant qu’elle reçoive sa peine. Je vais expliquer brièvement les deux. Il y a donc trois conditions pour toutes les affaires transférées à la justice réparatrice, et la juge Loparco en a mentionné deux : le contrevenant doit d’abord reconnaître sa responsabilité. Il doit y avoir acceptation des faits qui seront transmis au médiateur. Et enfin, il nous faut le consentement de toutes les parties pour participer à la démarche.
Je vais donc expliquer d’abord la déjudiciarisation. On l’utilisera généralement pour les affaires moins graves du Code criminel. En certaines circonstances exceptionnelles, il peut s’agir quand même d’affaires graves, qui peuvent supposer une agression sexuelle ou un homicide. La décision d’orienter une affaire vers la déjudiciarisation incombe uniquement à la poursuite. Le tribunal n’est pas vraiment impliqué dans ce choix, si ce n’est pour demander si la Couronne a demandé de renvoyer l’affaire en justice réparatrice. Le résultat final des affaires qui sont redirigées vers la justice réparatrice, si elles aboutissent, serait un retrait des accusations.
Pour la deuxième voie, vous vous souvenez que le transfert d’une affaire aura lieu une fois que la personne a été reconnue coupable à la suite d’un procès pour une infraction criminelle, ou a plaidé coupable d’un acte criminel. Encore une fois, tous les chefs d’inculpation du Code criminel sont admissibles, même les infractions les plus graves. Donc, les homicides, les agressions sexuelles et les voies de fait très graves. Toutes ces infractions sont admissibles à ce stade. On doit toutefois faire preuve de prudence si on redirige une affaire, surtout lorsque les délits impliquent de la violence fondée sur le genre ou de la violence conjugale ou sexuelle. Dans ces cas, une approbation du juge qui préside l’audience est nécessaire et il s’agit du juge qui prononcera la peine du contrevenant, parce que, si on se rappelle bien, le juge vient juste d’entendre les faits d’un plaidoyer de culpabilité et a déclaré la personne coupable, ou encore il vient de présider un procès à la suite duquel le contrevenant a été trouvé coupable.
L’audience sera ajournée si le juge consent à ce que l’on suive la procédure de la justice réparatrice. Si la démarche réussit, un rapport sera préparé par le médiateur de la justice réparatrice. Ces rapports ont été très utiles par le passé, pour ceux qui ont été rédigés à l’intention des juges chargés de déterminer les peines dans notre tribunal. Il se peut que ce rapport formule une suggestion quant à la peine que les parties souhaiteraient voir imposer. Si c’est le cas, ce sera certainement informatif et pertinent pour le juge, mais cela ne lie pas le juge lors de la détermination d’une peine. L’indépendance de la magistrature doit être telle que le juge peut tenir compte de la recommandation, mais il n’est pas tenu de le faire. Si la démarche de justice réparatrice échoue, l’affaire poursuit simplement son cours dans le système judiciaire. Si c’est le cas, rien de ce qui a été dit – aucune discussion ni aucune information partagée durant la démarche de justice réparatrice – ne pourra être utilisé lors de l’audience du tribunal. Ces discussions et ces informations seront alors considérées comme privilégiées et confidentielles.
Enfin, même si j’ai mentionné précédemment que l’on doit faire preuve de prudence avec certains types de délits lorsqu’on dirige une affaire vers des organismes de justice réparatrice, surtout dans les cas de violence sexuelle, de violence fondée sur le genre ou de violence conjugale, les organismes de justice réparatrice qui prennent en charge ce type d’affaires ont besoin d’une formation spécialisée pour le faire. Et surtout, ces organismes sont aussi libres de refuser la prise en charge de telles affaires s’ils ne veulent pas s’en occuper. Elles n’ont certainement pas d’obligation.
Alors c’est donc ainsi, en quelques mots, que fonctionnent la déjudiciarisation et la voie des mesures précédant la détermination de la peine.
Andrea Menard : C’est fantastique. Merci, juge en chef adjointe Joanne Durant, pour ce survol.
Ma prochaine question concerne la pertinence du travail de justice réparatrice dans la communauté et sa place dans le système juridique pénal. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet, juge Christopher?
Juge Michelle Christopher : Eh bien, selon moi, il s’agit d’une mesure de la façon dont le système de justice réagit à la diversité de participants qui entrent en conflit avec la loi et les tribunaux.
Les approches de la diversité et des différences culturelles ont évolué, et sont beaucoup plus nuancées et sensibles de nos jours qu’il y a même 10 ans, par exemple. Dans le milieu universitaire, nous parlions du développement de la compétence culturelle et même d’aisance culturelle; aujourd’hui, nous avons réalisé que ces concepts sont vraiment imparfaits. Tout ce que nous pouvons vraiment espérer est une sensibilisation culturelle englobant le respect et la diversité des personnes avec qui nous sommes en contact et qui viennent d’un endroit différent, de lieux de diversité, que ce soit en ce qui concerne la race ou les expériences de vie ou d’autres facteurs touchant la diversité, comme la façon dont une personne s’identifie, son orientation sexuelle… toutes ces choses. Alors, nous avons réalisé que ces discussions sur la sensibilisation culturelle, le respect, la dignité ou d’autres manières d’être ou de faire sont importantes. Nous avons aussi replacé le tout dans le contexte du système judiciaire, en constatant que les taux de règlement à l’amiable pour les procès avoisinent les 96 ou 97 %, ce qui nous confirme que bien des affaires qui commencent dans le système de justice n’ont pas vraiment besoin d’une réponse ou de l’intervention du système de justice parce qu’elles peuvent être résolues en dehors des tribunaux ou, comme on pourrait dire, sur les marches des palais de justice.
Donc les tribunaux, par le biais de divers programmes, redirigent la résolution de différends vers les participants et on peut le constater à travers le continuum de la résolution des différends avec des programmes de médiation qui sont désormais rattachés aux tribunaux, des programmes de méd-arb, des programmes d’arbitrage et, plus récemment, la création de tribunaux et de processus judiciaires spécialisés. En Alberta, nous disposons par exemple de processus pour reconnaître les initiatives de déjudiciarisation en matière de santé mentale, de tribunaux pour la violence conjugale, de tribunaux pour le traitement de la toxicomanie, de tribunaux autochtones et d’autres mécanismes spécialisés qui englobent ou qui sont coordonnés aux processus judiciaires officiels. Et c’est là, selon moi, que la justice réparatrice entre en scène. Elle vient légitimer et faciliter le recours à des principes juridiques traditionnels ou coutumiers – les lois autochtones, par exemple – qui reflètent et reconnaissent les différences culturelles et ce qui est important pour ces communautés, alors nous essayons de les respecter selon leurs propres conditions. Et d’une certaine façon, je crois que les systèmes dont nous disposons deviennent plus complémentaires. Alors, nous aimerions, avec des programmes de justice réparatrice, rencontrer ces participants divers là où ils se trouvent, au lieu de les faire venir à nous afin de participer à quelque chose qui n’est pas vraiment constructif. Et je crois que pour les contrevenants autochtones, le manque de pertinence dans les processus de ce que je pourrais appeler la justice pénale ordinaire, par exemple, fait en sorte que ces contrevenants récidivent souvent parce que ce qu’offre le programme existant ne répond pas vraiment à leurs besoins – il ne les aide pas à guérir, ne les rebranche pas à leur communauté et ne leur permet pas de réparer les torts causés aux victimes ou à la communauté d’une manière qui soit constructive pour eux, qui soit culturellement appropriée et qui réponde aux besoins de leur système de justice traditionnel autochtone.
Alors, nous essayons de rencontrer les participants dans la communauté, dans une certaine mesure, et nous légitimons l’utilisation de leurs ordonnances juridiques dans notre système existant. C’est à peu près là où nous nous trouvons à l’heure actuelle.
Denise Webb : Incroyable. Merci. Voilà qui nous aide vraiment à brosser un tableau de la nécessité de la justice réparatrice dans les tribunaux et de la place qu’elle peut y occuper.
Ma prochaine question est aussi pour vous, juge Christopher, et pour la juge Loparco. Je me demande… dans vos mots de présentation, vous avez toutes deux partagé certaines expériences vécues à l’extérieur de ce projet en matière de justice réparatrice comme telle, de justice réparatrice pour les jeunes et de travail avec les communautés et je me demandais si vous pouviez vous appuyer sur ces expériences, en plus de l’expertise que vous possédez dans le cadre de ce projet, afin de nous aider à mieux comprendre les liens entre ces travaux et la justice réparatrice au sens plus large, pour la santé, le mieux-être et la guérison des contrevenants comme des victimes… Peut-être pourrions-nous commencer par la juge Christopher?
Juge Michelle Christopher: Je crois qu’il s’agit là d’une vraie bonne question, car elle illustre vraiment l’importance des liens entre les acteurs du système de justice et les personnes qui y sont impliquées et qui se présentent devant nous. Nous sommes conscientes que les personnes qui interagissent avec le système de justice s’y présentent souvent avec des problèmes sous-jacents, et ce sont ces choses-là qui font en sorte qu’ils sont en conflit avec la loi. Par expérience, nous savons que si nous agissons sur les causes profondes du comportement d’un contrevenant, nous réalisons souvent que ces personnes ne reviennent pas dans le système de justice et ne récidivent pas.
Alors, la base de la justice réparatrice est, bien sûr, comme l’ont expliqué la juge Loparco et la juge en chef adjointe Durant, d’agir sur les préjudices causés aux personnes dans la communauté en offrant la possibilité aux contrevenants de prendre la responsabilité et de rendre compte de leurs gestes, souvent par le biais de plans de guérison et de programmes qui ciblent les problèmes précis qui les ont menés devant les tribunaux, qu’il s’agisse de troubles de santé mentale, d’un traumatisme ou d’un traumatisme intergénérationnel ou autre, de dépendances, d’une famille dysfonctionnelle ou autre chose. Il est donc particulièrement important, par exemple, avec les contrevenants autochtones, de reconnaître les systèmes de justice autochtones, où on met l’accent sur les erreurs, et non sur la criminalité ou sur un comportement criminel –concept qui n’est pas intégré à la justice autochtone ou au droit coutumier. Il fait appel à des plans de guérison visant l’acceptation, par le contrevenant, sa victime et la communauté, du comportement considéré comme mauvais ou de l’erreur.
Dans ce contexte, la justice réparatrice suppose que l’on travaille avec la communauté pour remédier aux torts causés et mettre en place divers mécanismes comme solution. Dans le contexte autochtone, il peut s’agir d’un cercle de détermination de la peine, une avenue utilisée dans certaines communautés. Il peut s’agir de soutien apporté par un aîné. Les Siksikas disposent par exemple d’un programme de soutien par des aînés, l’Elder Support Program, où les personnes qui ont des démêlés avec la justice travaillent avec des aînés dans le cadre d’un programme appelé Ask a Pimacuxe (demandez à un Pimacuxe) qui vise à corriger les erreurs commises et les torts qui ont été causés et à en guérir. Divers programmes d’artisans de la paix sont aussi en place – c’est le cas par exemple chez les Kainai ou les Tsuut’ina. Et nous avons un autre moyen d’appliquer ces principes : par la conclusion de partenariats juridiques médicaux où nous avons réalisé, notamment en travaillant avec les membres marginalisés ou vulnérables de la communauté, que si nous agissons sur leurs problèmes de pauvreté, de manque d’éducation ou de consommation de substances, la résolution des problèmes avec la justice suit de très près celle des problèmes médicaux qui les affligent. Il peut, par exemple, y avoir une personne qui a des problèmes de santé découlant de sa consommation de substances qui commet un délit en raison d’une dépendance. Si on règle ses problèmes avec le système de justice en même temps que ses problèmes médicaux, il semble que dans les deux cas, sa santé globale, son mieux-être et le bien-être général de cette personne peuvent s’améliorer parce que des problèmes juridiques ne viennent pas s’ajouter à ses problèmes médicaux ou de santé existants. Ces aspects sont vraiment intimement liés aux problèmes juridiques; la santé et le mieux-être des contrevenants s’améliorent une fois que leurs problèmes juridiques sont réglés.
Ce n’est là qu’un autre exemple des avantages qu’apporte une vaste consultation auprès des membres de la communauté pour trouver la bonne solution, et c’est en quelque sorte la base de ce que nous appelons aujourd’hui l’approche « aux multiples portes » pour la résolution des problèmes juridiques.
Denise Webb : Merci. Juge Anna Loparco, avez-vous quelque chose à ajouter concernant le lien entre ces travaux et la santé et le mieux-être des victimes et des contrevenants?
Juge Anna Loparco : Eh bien, si vous n’y voyez pas d’inconvénients, j’aimerais vous parler de deux exemples concrets qui se sont produits dans nos tribunaux, à la Cour du Banc du Roi. Il s’agit de deux décisions publiées, et je crois qu’elles sont importantes et pertinentes, car elles permettent d’expliquer pourquoi la justice réparatrice a eu des conséquences heureuses pour les personnes impliquées. Et quand je dis « heureuses », je veux aussi parler de conséquences qui ont eu une action réparatrice.
La première affaire – ce sont de longues causes, elles ont été publiées et vous pouvez donc les lire. La première est l’affaire R. c. Lariviere et en gros, il s’agit d’une affaire d’agression sexuelle majeure, passée à l’histoire et survenue en 1977. La victime avait 18 ans à l’époque et assistait à un tournoi de balle à Cold Lake, en Alberta. L’endroit où elle devait passer la nuit à cette occasion n’était plus disponible, alors M. Lariviere, qu’elle connaissait bien et qu’elle considérait comme un oncle – non sur le plan biologique, mais parce qu’il était un ami de la famille – lui offre alors de rester avec lui et de passer la nuit dans sa tente. Il avait 32 ans à l’époque et avait des problèmes de dépendances. Elle a partagé son sac de couchage et en se réveillant le lendemain, elle ne se sentait pas bien – ses vêtements étaient tout emmêlés et elle avait mal partout. Une fois de retour chez elle, elle a découvert, au fil des semaines, qu’elle était enceinte. Elle a donné naissance à un garçon, et avec les années, elle a souffert d’idées suicidaires, de dévalorisation et de honte. Elle a gardé le secret et a vécu dans la crainte que d’autres personnes découvrent qu’elle avait été violée et qu’un enfant était né de cette agression. Ce n’est qu’une fois ses parents décédés qu’elle a eu le courage d’aller de l’avant, de tout dire à sa sœur et de se rendre à la GRC. Un test d’ADN a confirmé que son fils, devenu adulte, était de fils de Lariviere qui, lors du procès, avait atteint l’âge de 75 ans et était affligé de nombreux problèmes médicaux.
Le rapport Gladue, fourni au juge présidant le procès, contenait une somme d’information considérable sur le séjour de Lariviere dans les pensionnats autochtones et sur celui de ses parents, et sur le traumatisme intergénérationnel qui en a résulté. Le contrevenant avait travaillé la majeure partie de sa vie. Il avait cessé de consommer de l’alcool en 1988, avait aidé d’autres personnes à faire face à des problèmes de dépendances et était perçu dans la communauté comme un mentor et un conseiller. Avant le procès, il n’était pas au courant de ces accusations ni du fait qu’il avait un enfant. Il n’a pas nié les faits, mais n’en avait simplement aucun souvenir. Il a donc plaidé non coupable. Il s’agit donc là d’un de ces exemples avant la détermination de la peine, où la personne a été reconnue coupable, puis où les parties ont décidé de se tourner vers la justice réparatrice avant que la peine soit déterminée.
Finalement, le point important à ce sujet est le fait que c’était une décision de la victime. C’est elle qui a insisté pour avoir recours à la justice réparatrice. Elle voulait obtenir des explications sur ce qui s’était produit, une reconnaissance des torts causés et, surtout, elle voulait que cet homme soit un éducateur auprès des jeunes de la communauté, afin que ceux-ci puissent comprendre ce qu’est le consentement dans les relations sexuelles – elle croyait que Lariviere était en bonne position pour le faire. Ils ont donc été dirigés vers la justice réparatrice. Le tout avait lieu en Saskatchewan, parce que la communauté où les faits s’étaient produits s’y trouvait. Ils ont fait appel à un organisme de Saddle Lake, qui jouit d’un respect énorme pour sa réputation en matière de services de justice réparatrice. Ils ont eu un dialogue sur la justice réparatrice, des membres de la communauté se sont impliqués pour les deux parties et on a, bien sûr, pris en compte l’âge de M. Lariviere et son piètre état de santé. Et surtout, elle ne voulait pas que son agresseur aille en prison. Elle croyait qu’il y avait une meilleure voie à suivre, qu’il était déjà engagé sur la voie de la guérison et que pour elle, justice avait été rendue grâce à sa condamnation et à la reconnaissance des torts qu’il avait causés.
À titre d’information, en Alberta, les peines pour les agressions sexuelles majeures comme celle-ci, en particulier si la victime est endormie ou inconsciente à la suite d’une intoxication et que l’agression a entraîné une grossesse – tous ces facteurs s’additionnent et entraînent normalement une peine d’emprisonnement. Or, comme je l’ai mentionné précédemment, un certain nombre de facteurs ont été pris en compte lorsque le rapport a finalement été renvoyé à la justice pour la détermination de la peine, le plus notable étant le fait que la victime estimait que justice avait été rendue et ne voulait pas que son agresseur aille en prison. Aussi le fait que l’homme était prêt à participer au Cercle et à s’en servir comme outil pour « désapprendre » les mauvais comportements, montrer du respect à l’égard des femmes et travailler à éduquer la prochaine génération. Alors, comme je le disais, des membres de la communauté et des aînés respectés ont participé à la démarche, qui a permis non seulement de guérir des individus, mais aussi toute la communauté. Et en fin de compte, la recommandation issue de cette démarche a été que le contrevenant reçoive un sursis de sentence avec probation de trois ans, selon la proposition de l’avocat de la défense. La Couronne voulait quand même une peine de prison de deux ans, compte tenu des facteurs aggravants. Finalement, le juge a décidé d’imposer un sursis de sentence avec probation de trois ans. Dans cette affaire, la juge Burns a livré des commentaires de grande importance. Elle a déclaré, entre autres : « Il ne sert à rien d’avoir un cercle de détermination de la peine si sa contribution n’est pas soigneusement examinée et, dans la mesure du possible, mise en œuvre », avant de parler de la nécessité de favoriser la réhabilitation, la réparation et la réconciliation.
Je voudrais aussi aborder très brièvement la deuxième affaire, plus récente, soit R. c. Rabbit. Cette affaire était du ressort de notre tribunal de Red Deer de la Cour du Banc du Roi. Dans cette affaire, M. Rabbit est une jeune personne qui restait souvent à la maison d’un aîné – pas un aîné au sens autochtone du terme, mais un homme plus âgé, parce qu’il y venait pour se dépanner et tenter de trouver ce qu’il allait faire de sa vie. Alors, ce vieil homme lui offrait de rester chez lui, ce qu’il a fait à de multiples occasions. Ils buvaient ensemble et un jour, la jeune personne a été agressée sexuellement, mais a tourné la page et n’a rien signalé. Puis un soir, lors de la soirée en question, lorsque le propriétaire de la maison est venu dans sa chambre en s’imposant de manière suggestive, M. Rabbit a paniqué et a attaqué l’homme, allant jusqu’à le tuer. Ce n’était nullement son intention, mais, vous savez, il avait été traumatisé par les événements qui s’étaient déjà produits et c’était une sorte de réaction instinctive pour lui. Il a plaidé coupable. Il n’avait pas de problème à le faire. Il a exprimé des remords sincères et profonds à la famille à la suite du décès de sa victime et voulait avoir recours à la justice réparatrice. Et dans ce cas, les juges impliqués dans l’affaire, tant pour la mise en liberté provisoire avec cautionnement que pour la détermination de la peine, ont tous deux reconnu que M. Rabbit avait quelque chose de spécial et qu’il était prêt à tout faire pour réparer ses erreurs, sensibiliser le public et améliorer le chemin pour les générations futures.
Il s’agissait là d’une question autochtone qui a été redirigée vers la justice réparatrice. La famille de la victime était d’accord. La sœur de la victime a assisté au cercle, qui a été pris en charge par la juge, soit la juge pour la détermination de la sentence, à même la salle du tribunal. La juge a vidé la salle d’audience et installé des chaises en cercle, puis ils ont formé, avec l’aide d’un aîné, un Cercle de détermination de la peine. C’était très émouvant. En fait, quand je lui en parle aujourd’hui, elle a les larmes aux yeux parce que ce fut une expérience vraiment bouleversante pour toutes les personnes impliquées. Lorsque M. Rabbit a expliqué ce qui s’était passé et à quel point il avait des remords, il était très clair que la justice aurait été bien mal rendue en l’envoyant en prison. À la place, il a reçu un sursis de sentence avec des conditions de probation très précises. Il continue d’écrire à la juge impliquée, je crois, tous les deux mois, pour lui faire part de ses progrès et s’assurer qu’un ensemble de services sont offerts pour la guérison de la famille de la victime, mais aussi pour aider la personne impliquée, soit M. Rabbit, à améliorer sa vie et à participer de manière constructive à son avenir, sans récidive. La juge m’a même dit, la juge Jillian Marriott : « Voilà un homme qui va changer le monde. » Alors, encore une fois, il s’agit là d’un exemple parfait de l’utilisation de la justice réparatrice pour la détermination d’une peine dans un contexte plus spécialisé, dans des cas particuliers qui, vous le savez, exigent une meilleure approche que celle de notre système ordinaire.
Denise Webb : Merci, juge Loparco, pour ce partage. Il nous confirme à quel point la justice réparatrice est, pour les contrevenants comme pour les victimes, une approche globale et axée sur les besoins. C’est incroyable.
La prochaine question s’adresse maintenant à tout le monde. Alors, pour les autres, qu’il s’agisse de communautés, d’organisations ou d’autres acteurs du système juridique – je me demande quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui aimeraient prendre part à ces travaux ou mettre sur pied leur propre programme de justice réparatrice à même le système juridique?
Andrea Menard : Merci, Denise. Je dois dire que je suis une grande partisane du pluralisme juridique. En tant que nations autochtones, nous avons nos propres lois. Michelle y a fait allusion. Nous avons le droit coutumier et le droit délibératif. Nos interactions sociales sont des lois, nous avons aussi un droit positiviste. La rationalité est une loi; l’aspect sacré de la vie, de nos relations entre nous et avec la terre et l’air sont aussi des lois. Il s’agit donc d’un excellent point de départ pour une discussion éventuelle avec les juges sur la question du pluralisme juridique. Comment allons-nous intégrer le droit autochtone aux systèmes actuels? En Alberta, nous faisons déjà un bon travail grâce au projet de justice réparatrice, alors faisons un pas de plus.
J’aimerais dire également qu’il est vraiment important d’adopter une approche sensible aux traumatismes. La juge Michelle Christopher précisait qu’il ne s’agit pas là de compétence culturelle et je suis d’accord avec elle. Il s’agit plutôt de savoir ce que sont les lois autochtones, de prendre conscience que nous ne sommes pas « pan-autochtones » et de comprendre que pour toute personne qui se présente devant les tribunaux, et pas uniquement des Autochtones, il nous faut nous montrer sensibles aux traumatismes. Cette approche est nouvelle, elle est essentielle et je pense qu’en l’adoptant, nous obtiendrons aussi des résultats.
Denise Webb : Merci, Andrea. Juge Loparco, auriez-vous des conseils pour les autres parties intéressées?
Juge Anna Loparco :Certainement. Nous constatons déjà des données très favorables issues de ce projet. Collectivement, nous avons transféré, de la Cour de l’Alberta et de la Cour du Banc du Roi, environ 300 affaires vers des organismes de justice réparatrice. Nous attendons, ultimement, des statistiques encore meilleures, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, afin de pouvoir produire un rapport sur les résultats définitifs issus de ce transfert. Nous espérons aussi que nous aurons suffisamment d’organismes de justice réparatrice pour répondre aux besoins et espérons que ces besoins grandiront à l’avenir.
Nous encourageons donc les organismes communautaires à se rallier et à se réunir pour créer des programmes, autochtones ou non, et le gouvernement de l’Alberta – il est important de le dire – après le lancement de notre projet, en 2022, a annoncé qu’il mettrait sur pied une stratégie de justice réparatrice, laquelle supposerait l’élargissement du financement pour les organismes et, nous l’espérons, certaines règles, peut-être des instruments législatifs à cet effet également. Il est donc important, pour les organismes que la chose intéresse, de contacter le gouvernement et de déposer une demande de financement; des personnes qui connaissent le dossier peuvent les guider aussi dans cette démarche.
Denise Webb : Juge en chef adjointe Joanne Durant, avez-vous des conseils pour les autres parties intéressées?
Juge en chef adjointe Joanne Durant : Je pense qu’en plus de ce qui a déjà été dit, j’encouragerais toute personne souhaitant mettre sur pied un tel système dans sa région ou sa province à entreprendre une consultation et une collaboration à grande échelle. Andrea en a fait mention un peu plus tôt et il est vraiment très important que le système qui sera éventuellement créé travaille avec les communautés qu’il desservira. J’encouragerais donc très certainement une telle démarche à voir le jour.
Denise Webb : En dernier lieu, juge Michelle Christopher, auriez-vous des réflexions ou des conseils à partager avec notre auditoire que ces travaux intéressent?
Juge Michelle Christopher : Well, I guess I would say based on our experience, the first thing to note is that this work takes time. And it also reflects the diverse concepts of time and relationships that we find when we engage with all the stakeholders who are interested in developing these kinds of programs. I agree with others who've spoken today that an essential part of this is the need to have broad-based stakeholder consultations. So, you have to be prepared to think outside the box, keep an open mind, engage widely with stakeholders, and cast that net really widely at the start and develop the relationships with those stakeholders.
Eh bien, je pourrais dire qu’en fonction de notre expérience, la première chose à souligner est le fait que ce travail exige du temps. Et cela reflète également les diverses conceptions du temps et des relations que nous découvrons lors de nos échanges avec tous les intervenants qui souhaitent mettre en place ce genre de programme. Je suis d’accord avec les autres personnes qui ont pris la parole aujourd’hui pour dire que des consultations à grande échelle avec les intervenants constituent une part essentielle de ces travaux. Vous devez donc être préparés à sortir des sentiers battus, à garder l’esprit ouvert, à vous engager à fond auprès des divers intervenants et à ratisser très large dès le départ, et à établir des relations avec ces parties prenantes.
Je vous dirais de faire preuve de patience et prenez conscience qu’il faut du temps. Recherchez des mentors, des personnes qui disposent déjà de programmes établis, apprenez de leurs expériences – les bonnes comme les mauvaises – et acceptez aussi qu’il faut beaucoup de sensibilisation auprès de divers intervenants et que ces programmes ne sont pas tous semblables. Donc, l’information offerte dans le cadre de notre projet pilote à l’intention des procureurs de la Couronne était différente de celle offerte aux avocats, qui elle était différente de celle destinée aux juges; il vous faut donc aller rencontrer les participants là où ils se trouvent, peu importe où ils se trouvent et favoriser les occasions pour eux de s’informer sur ce en quoi consistera la portion qui les concerne dans le système.
Denise Webb : Merci beaucoup pour cette intervention. Cette démarche est tellement intuitive, importante et constructive.
Alors la dernière question s’adresse aussi à vous toutes : pourrions-nous conclure en nous demandant ce que l’on aimerait pour l’avenir en ce qui concerne le projet de justice réparatrice wîyasôw iskweêw. Madame la juge Loparco?
Juge Anna Loparco : Eh bien, nous espérons continuer d’accroître l’étendue de ce projet. Nous nous concentrons présentement sur le volet criminel du projet, bien sûr, et sur la collecte de statistiques. Nous en sommes maintenant à la phase d’information et d’évaluation du projet, laquelle inclut entre autres ce que nous faisons aujourd’hui dans le cadre de ce balado. Alors, encore une fois, merci pour cette merveilleuse occasion. Dans le cadre de cette phase, nous encourageons aussi les membres de la communauté à aller de l’avant et à créer de nouveaux organismes parce que comme je l’ai dit, nous voulons couvrir tout le territoire afin que la justice réparatrice soit accessible dans toute la province, alors on y travaille. Nous aimerions pouvoir compter sur un plus grand nombre d’organismes qui pourraient se joindre à nous et devenir partenaires dans le cadre de ce projet. Nous avons discuté de la possibilité d’étendre le projet, peut-être, au droit de la famille, aux affaires de protection de l’enfance et à d’autres affaires civiles de l’État. Il y aurait aussi certainement la possibilité d’appliquer les pratiques propres à la justice réparatrice à tous les domaines, mais nous faisons un pas à la fois et nous voyons au fur et à mesure comment les choses se passent.
Denise Webb : Merci. Et vous, juge en chef adjointe Joanne Durant?
Juge en chef adjointe Joanne Durant : Merci. Je crois qu’en plus de tout ce qu’Anna a dit, la seule chose que j’ajouterais est qu’idéalement, nous aimerions vraiment que le Conseil et la Cour prennent l’habitude de se pencher sur la possibilité de faire appel à la justice réparatrice dans toutes les affaires pénales. Et ensuite, si la formule s’étend à d’autres domaines également, qu’on en vienne à ne pas considérer le tout comme une demande inhabituelle, mais que ce soit quelque chose qui soit pris en compte dès le début. Je crois que c’est ce que j’aimerais voir à l’avenir. Et encore une fois, je parle en mon propre nom, et non en celui du tribunal, mais idéalement, il faudrait que ce soit normal pour nous d’y penser au lieu que ce soit une exception.
Denise Webb : Juge Michelle Christopher, avez-vous des réflexions à partager, pour conclure, sur ce que vous souhaiteriez pour l’avenir?
Juge Michelle Christopher : Eh bien, je ne voudrais pas avoir le dernier mot, mais je dirais qu’en mon nom personnel et non au nom de la Cour ou en mon nom en tant que juge, je souhaiterais idéalement que l’Alberta suive l’exemple d’autres gouvernements qui ont intégré la justice réparatrice à leurs lois. Donc, des administrations comme celles du Manitoba, de la Jamaïque ou de la Nouvelle-Zélande ont adopté des lois afin d’obliger ou de faciliter le recours à des programmes de justice réparatrice dans les tribunaux. Le Manitoba, en particulier, a mis sur pied le Conseil consultatif de la justice réparatrice du Manitoba et est doté d’une Loi sur la justice réparatrice qui prend en charge les comportements illégaux en dehors du processus de justice pénale traditionnel en offrant bien entendu aux contrevenants et aux victimes la possibilité de participer à une démarche de justice réparatrice, mais aussi en exigeant des contrevenants qu’ils suivent un traitement ou aient recours à du counseling pour remédier à leurs problèmes sous-jacents de santé mentale, de dépendances ou d’autres délits liés à leur comportement. Alors, au Manitoba, la loi est telle que les programmes de justice réparatrice peuvent être utilisés avant ou après que les personnes aient été accusées d’un délit, et lorsque ces personnes participent à un programme autorisé par la loi. La loi définit en quelque sorte tous les éléments de base de ce que nous comprenons comme étant la justice réparatrice de nos jours, y compris les excuses aux victimes et aux autres membres de la communauté touchés, la participation à la médiation ou la réconciliation, le versement d’un dédommagement, la participation à des travaux communautaires ou à des séances de counseling ou de formation, ou à des programmes de traitement.
So, it requires the Department of Justice to develop policies respecting the use of restorative justice programs, so it's a must in the legislation. If I could wish for one thing, it would be that Alberta would be as progressive as that and legislate this into being. And then I think that would meet some of the comments made by Deputy Chief Justice Joanne Durant, where this is routine, it's the default. We start there rather than view it as an exception, or as Justice Loparco says, it’s widely used not only in the criminal justice system, but in family and civil context to resolve disputes.
Il faut donc que le ministère de la Justice élabore des politiques concernant le recours à des programmes de justice réparatrice, et il est essentiel que ce soit précisé dans la loi. Si je pouvais souhaiter une chose, ce serait que l’Alberta soit aussi progressiste que cela et que la province légifère en ce sens. Et je crois qu’ainsi, cela répondrait à certaines des observations formulées par la juge en chef adjointe Joanne Durant, à savoir que c’est pratique courante et que cela va de soi. C’est là le point de départ au lieu de voir le tout comme une exception ou, comme le disait la juge Loparco, que la justice réparatrice devienne un outil largement utilisé non seulement dans le système de justice pénale, mais aussi en droit familial ou civil pour la résolution de différends.
Donc, je crois que nous sommes en train de nous rapprocher de la façon dont les conflits ont été résolus pendant des millénaires, non seulement dans le contexte autochtone, mais aussi dans d’autres situations où on n’affirmait pas systématiquement qu’on allait se voir en Cour et faire un procès afin qu’un juge décide de tout et qu’on mette des gens en prison parce qu’on ne sait pas comment remédier aux comportements délinquants. Je crois que nous sommes en train de nous rapprocher de ce qui se fait dans certaines communautés depuis des millénaires, comme je l’ai dit précédemment.
Quoi qu’il en soit, je vous remercie de m’avoir offert la possibilité de parler de justice réparatrice et du travail que nous avons fait.
Denise Webb : Wow, merci pour tout cela. Je dois répéter qu’il serait merveilleux que la justice réparatrice devienne la norme acceptée dans la réalité, comme l’a mentionné la juge Joanne Durant et comme vous l’avez réitéré, juge Christopher, et qu’elle soit intégrée à des instruments législatifs. Ce serait formidable.
Andrea, avez-vous une vision pour l’avenir de ce projet?
Andrea Menard :Eh bien, nous sommes engagés sur la bonne voie ici en Alberta avec les juges. Mais nous aimerions vraiment pouvoir bénéficier d’un financement récurrent pour les communautés, qui doivent refaire des demandes chaque fois pour ces subventions, et ce que j’aimerais voir ici en Alberta est un programme de justice réparatrice en milieu urbain pour les nations autochtones. Il nous arrive, en tant qu’Autochtone vivant en milieu urbain, de passer sous le radar. La situation est complexe. Alors, qui allons-nous obtenir pour joindre les cercles? Qui va présider le cercle? Je suis convaincue que nous pourrons trouver une solution. Mais nous avons besoin de la justice réparatrice en milieu urbain pour les populations autochtones ou non autochtones, ainsi que d’un financement récurrent – car nous continuons de demander des subventions et il arrive parfois que nous n’en obtenons pas. Ce sont là mes dernières réflexions. Merci, Denise.
Denise Webb : Merci. Et Andrea, aimeriez-vous conclure par des réflexions ou des commentaires sur notre entretien d’aujourd’hui et sur ce que nous avons appris sur la pertinence de la justice réparatrice et de ce programme?
Andrea Menard : Eh bien, je suis installée sur le territoire du Traité 6, ici en Alberta, et j’adore cette équipe de juges et ce qu’elles ont fait, encore une fois en ratissant large et en répondant aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation.
Je vais mentionner de nouveau le pluralisme juridique. Où sont les lois autochtones dans tout cela? Commençons à y réfléchir et à intégrer des lois autochtones dans les systèmes juridiques coloniaux actuels, dans les décisions juridiques et dans les façons de faire. Oui, le Manitoba possède des lois formidables. C’est là une autre avenue à emprunter si nous ne pouvons pas tout laisser tomber et intégrer le droit autochtone. Nous devrions aussi porter notre attention vers le First Nations Justice Council (Conseil de justice des Premières Nations) de la Colombie-Britannique et nous pencher aussi sur ce qu’ils ont fait.
Encore une fois, nous devrons être tous prêts à prendre le virage et j’ai bien hâte de voir les possibilités qui en résulteront, car nous disposons d’une équipe solide, et je suis convaincue que nous y arriverons.
Denise Webb : Merci, Andrea, et merci pour cette conclusion teintée d’un optimisme sincère. Et merci beaucoup à toutes d’avoir pris le temps de partager vos réflexions et vos expériences avec nous aujourd’hui. Je suis convaincue que notre public sera ravi de vous écouter et d’apprendre de vous, comme je viens de le faire moi-même. Vos propos sont inspirants et pertinents. Merci.
Merci, Andrea, et merci pour cette conclusion teintée d’un optimisme sincère. Et merci beaucoup à toutes d’avoir pris le temps de partager vos réflexions et vos expériences avec nous aujourd’hui. Je suis convaincue que notre public sera ravi de vous écouter et d’apprendre de vous, comme je viens de le faire moi-même. Vos propos sont inspirants et pertinents. Merci.
Denise Webb : Thank you, Andrea, and thank you for ending us on that sincere optimism. So, thank you all so much for taking the time and sharing your thoughts and experiences with us today. I'm sure the listeners will really appreciate hearing and learning from you just as I have. It's all so inspiring and meaningful. Thank you.